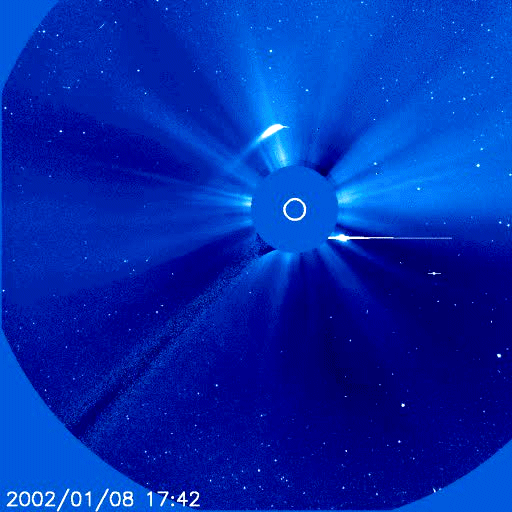
Eruption solaire stimulée par le passage d'une comète
23 décembre 2004
Frérédic Deroche m'a signalé un site :
http://www.jmccanneyscience.com
qui est celui de Jim Mac Canney, lequel montre d'intéressantes vidéos se référant à des passages de comètes à proximité du Soleil. Ces images sont prises à l'aide d'un coronographe, dispositif simple où l'image du Soleil est occultée par un disque fixé au bout d'une tige (visible). On distingue alors la structure de la couronne solaire. Une comète représente une masse très faible à l'échelle de celle du Soleil. Celle de Halley a les dimensions d'une colline et est moins massive. L'effet gravitationnel, l'effet de marée peut donc être considéré comme assez négligeable. Par contre la comète, en approchant du Soleil, traverse un vent solaire très intense. On peut penser alors qu'elle acquiert une charge électrique importante. Dans le film on pourra voir, au moment où la comète se trouve très proche du Soleil, qu'une éruption Solaire de grande intensité se manifeste. On peut penser que le déclencheur pourrait être de nature électromagnétique. Voici d'abord quelques images extraites du film :
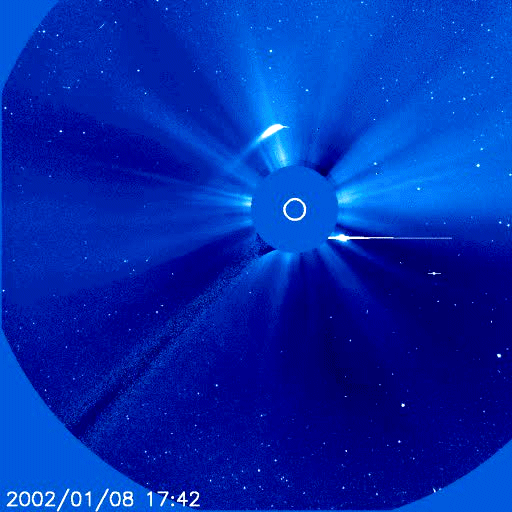
Juste avant le déclenchement du phénomène
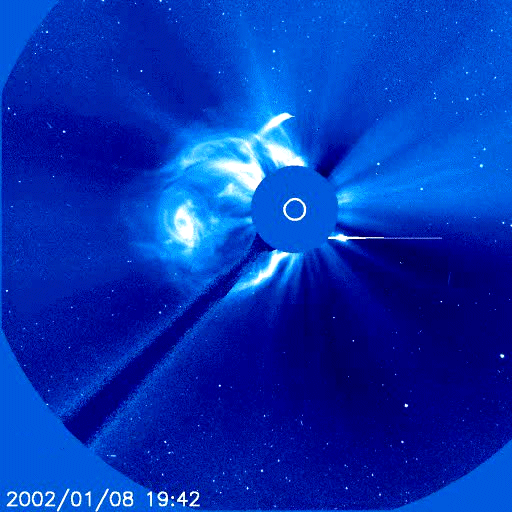
Déclenchement très rapide de l'éruption solaire
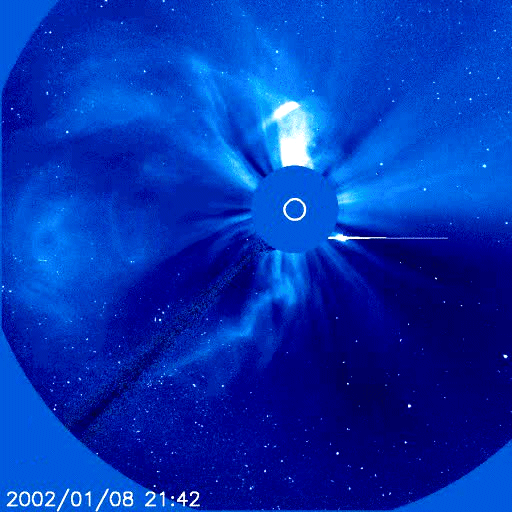
Avant l'achèvement de l'éruption
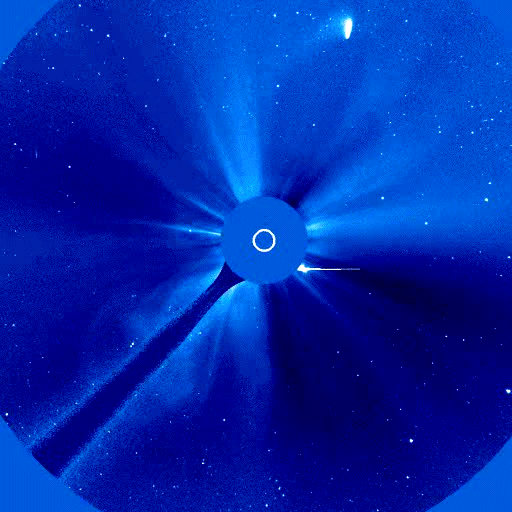
La comète s'éloigne
Pour voir le film ( mpeg 2 mégas )
Il s'agit là d'une éruption solaire stimulée. On sait que celles-ci ont un effet sur le climat terrestre. Il ne serait pas impossible que les débris d'un objet fragmenté par effet de marée ne viennent en masse solliciter un jour le soleil, en lui conférant une activité, passagère, mais peut être extrêmement intense, voire dommageable. On connaît assez mal cet ensemble de phénomènes, de même qu'on évalue mal les interactions de type électromagnétique entre planètes et objets errants. On constate, par l'étude du paléomagnétisme qu'il y a eu de fortes variations de la géométrie magnétique terrestre. A quoi ces phénomènes pourraient-ils être imputés? On peut d'abord rappeler une chose : l'origine du champ magnétique terrestre reste indéterminée. Le lecteur a sans doute souvent entendu parler "d'effet magnéto". Cela reste ... un mot. J'ai assisté il y a quelques années à une conférence faite à Marseille par un astrophysicien qui s'était spécialisé dans ce genre d'étude. A l'issue de celle-ci il devenait clair qu'en un demi-siècle les théoriciens n'avaient pas progressé d'un pouce. Si on ne sait pas pourquoi la Terre se doterait d'un champ magnétique, comment pourrait-on imaginer le phénomène qui pourrait inverser celui-ci ?
Je pense personnellement que nous ne connaissons que très partiellement les objets qui composent le système solaire. Nous avons des données sur des objets qui restent bien tranquilles sur leurs orbites : planètes et satellites, mais nous ne savons pas grand chose sur d'éventuels objets errants, susceptibles de créer des perturbations. Ce qu'on sait, depuis les travaux de J.M.Souriau, c'est vers quoi tend le système solaire : vers un état relaxé, où intervient d'ailleurs le nombre d'or. Dans cet état relaxé les planètes tendent à se localiser dans un même plan : celui de l'écliptique. Les orbites se circularisent. Les spins des planètes et satellites s'alignent. Ce qui mène le jeu ce sont les effets de marée, dissippatifs, malheureusement difficiles à évaluer et à modéliser. Il y a eu des analyses du système solaire effectuée à grand renfort d'ordinateur, en représentant les planètes et autres objets comme des sphères de densité constante. Alors "des phénomènes chaotiques" peuvent faire basculer l'axe de planètes, etc. Et d'écrire que la vie de saurait se développer sur une planète qui ne serait pas accompagné par un satellite, comme la nôtre, parce que les "phénomènes chaotiques" pourraient engendrer des basculements imprévisibles de l'axe de rotation.
Je suis d'accord avec Souriau qui dit que cette approche n'est pas valable parce qu'elle ne prend pas en compte les phénomènes dissipatifs. Que faut-il entendre par là ? Prenons d'abord un exemple de système binaire supposé à priori non dissipatif. C'est le tandem Pluton-Charon. Ceux là sont censés orbiter autour d'un centre de gravité commun "en se regardant dans le blanc des yeux", de manière "plutostationnaire". Alors chaque astre déforme l'autre selon un ellipsoïde qui pointe sont grand axe vers lui.
Mais s'il s'agit d'objets qui orbitent autour d'un centre de gravité commun et s'ils ont eux mêmes des mouvements de rotation propres, alors leur surface, et même toute leur masse sont parcourues par ce qu'on pourrait appeler une "onde de densité". C'est ... un vague. La Lune déforme ainsi la surface de la Terre en y créant une vague d'un mètre d'amplitude ( qui fait le tour de la Terre en 24 heures ). La Lune donne en permanence à la Terre la forme d'un ellipsoïde allongé. Si la Lune orbitait à 40.000 kilomètres de la Terre, elle serait géosynchrone. La vague terrestre serait stationnaire et il n'y aurait pas de phénomène dissipatif. Mais ça n'est pas le cas. La Lune orbite autour de la Terre en 28 jours alors que la Terre tourne sur elle-même ... 28 fois plus rapidement. Elle entraîne donc cette "vague" terrestre avec elle. Accessoirement ce léger dipôle modifie la trajectoire de la Lune, comme le ferait un dresseur, dans un manège, qui tirerait sur la longe d'un cheval de manière à lui faire presser le pas. La Terre communique de l'énergie à la Lune qui s'éloigne ainsi de nous à raison de 4 cm par an. Inversement notre satellite ralentit le mouvement de rotation terrestre. Les jours étaient plus courts dans le passé.
Le déplacement relatif de cette onde de densité, de cette vague qui balaye la terre en 24 heures implique un brassage, donc un échauffement et in fine une dissipation d'énergie par rayonnement.
Les deux objets interagissent. Actuellement, la Lune présente un mouvement d'oscillation, qu'on appelle libration, qui fait que la Lune montre non 50 % de sa surface, mais 59 %. Antérieurement, la Lune tournait probablement sur elle-même. Si elle est née en tant qu'éjecta, à la suite d'une collision avec la Terre elle possédait peut être un magma, ou en tout cas sa fluidité pouvait être plus grande. L'évolution du système Terre Lune reste à modéliser. C'est effectivement depuis une date relativement récente que cette hypothèse de la création de la Lune à la suite de la collision de la Terre avec un astre de la taille de Mars a repris du corps. La distribution de la masse lunaire ne présente pas une symétrie sphérique. La Lune présente un balourd. Cela irait avec l'hypothèse selon laquelle, lorsque la Lune s'est formée, elle pouvait constituer un objet relativement fluide. Ainsi les espèces les plus denses auraient pu migrer vers son centre et, subsidiairement, vers la face dirigée vers la Terre. Puis, avec le temps, le magma lunaire ne peut que se refroidir, jusqu'à figeage, ce qu'indique l'absence constatée de sismicité lunaire.
Revenons au système solaire. Io tourne très près de Jupiter, et tourne également sur lui-même. Jupiter tend à donner à Io une forme légèrement elliptique (toujours en ellipsoïde allongé). La rotation de Io implique un brassage de l'astre. Là, le phénomène dissipatif est immédiatement visible : il entretient un volcanisme intense sur Io. Le magma de Io ne risque pas de se refroidir, étant réalimenté en énergie en permanence par le malaxage que lui imposer "quotidiennement" Jupiter (au rythme de la rotation de Io sur lui-même, en 1,77 jours terrestres). Les astronomes pensent que le malaxage de Io pourrait également être imputé à la présence de ses cousines Europe et Ganymède.
Les mécanismes dissipatifs entraînent les systèmes vers des états où les échanges d'énergie sont minimaux. Si on avait un système planétaire constitué par une étoiles et deux planètes, tournant autour de celle-ci avec des périodes T1 et T2, celles-ci interagiraient en utilisant le matériau fluide de l'étoile comme "antenne". Elles déformeraient la surface de l'étoile, ce qui altérerait la géométrie du champ gravitationnel. Le système évoluerait jusqu'à ce que les orbitent correspondent à un état d'échange minimal, c'est à dire jusqu'à ce que les rapports des périodes correspondent au "nombre le moins résonant", plus connue sous le nom de nombre d'or.
![]()
Si un système est constitué par plusieurs planètes, les effets dissipatifs tendent à placer les planètes selon des orbites circulaires, distribuées non selon la loi de Titus- Bode (qui représente une version approchée) mais selon la loi dorée de Souriau :
1,9n
La loi de Titus Bode étant :
2,4 ( 0,4 + 0,3 x 2n )
Ci-après, les deux lois, comparées :

Lois, en coordonnées logarithmiques.
Mais le système solaire ne correspond pas exactement à cette ou ces lois. Il existe des écarts. Le système possède une ceinture d'astéroïdes. Pluton orbite dans un plan assez différent de celui de l'écliptique. L'orbite d'Uranus est complètement couché dans ce plan, etc. D'où cela vient-il ? De quand cela date-t-il ? Nous n'en savons rien, de même que nous ne connaissons pas l'âge des ... anneaux de Saturne. Nous savons seulement que ces anneaux se situent à l'intérieur de la sphère de Roche de la planète, espace à l'intérieur duquel un corps dont les composants ne seraient liés que par la force gravitationnelle qui les lie serait disloqué. Saturne a un diamètre de 120.660 km. La diamètre de sa sphère de Roche est donc de 2,5 x 10.660 = 300.000 km. Effectivement, le diamètre de l'anneau D, découvert en 1969 par l'astronome français Pierre Guérin, au télescope du Pic du Midi, se trouve à 141.000 km du centre de Saturne. Il est donc possible que ces anneaux soient le reste d'un ou de plusieurs satellites qui, du fait de l'usure de leurs orbites auraient pénétré dans cette région et auraient été broyés. Mais quand ? Mystère. Les anneaux de Saturne peuvent avoir dix mille ans d'âge ou des milliards d'années.
Il est bon de prendre conscience de notre ignorance. De même, nous ne savons pas vraiment comment le système solaire s'est formé, planétoïdes ou pas planétoïdes. L'invention d'un mot n'a jamais clos un problème. Je me souviens qu'il y a moins de dix années Pierre Guérin me disait "tu sais, si tu racontes à droite et à gauche que le Soleil est né dans un amas d'étoiles, tu te feras mal voir". A l'époque, la thèse dominante était celle d'une naissance isolée. Pourquoi ? Allez donc savoir. Un "effet de consensus", sans doute. Un jour le journaliste scientifique Serge Jodra publia un papier dans Ciel et Espace intitulé "mais où sont passées les soeurs du Soleil". Aujourd'hui le consensus s'est déplacé au profit d'une naissance du Soleil dans un amas d'étoiles. Combien y en avait-il, quelles étaient leurs masses ? Difficile à dire. Jodra hasardait le chiffre de deux cent, comme ça.
Ce qu'on peut imaginer c'est que dans un jeune amas de ce style les interactions entre objet récemment formées, sous forme de proto-étoiles, pouvaient être intenses. Avec deux mécanismes extrêmes : le "cannibalisme" et l'effet de fronde. Le cannibalisme est facile à imaginer. L'effet de fronde communique aux objets les plus légers un excès de vitesse, qui peut les éjecter hors de l'amas ( de la même façon, le système solaire a éjecté les plus petits débris, qui sont allés soit se perdre dans le milieu interstellaire, soit ont constitué cette lointaine banlieue où "vivent" comètes et astéroïdes. Dans cette optique, en revenant à cette dynamique de l'amas les étoiles les plus légères seraient-elles celles qui le quitteraient les premières. Il faut voitr là la manifestation d'une tendance vers l'équilibre thermodynamique. Ces proto-systèmes solaires se comportent comme les molécules d'un gaz. Leurs interactions avec échanges d'énergie cinétique tendent à donner à leur distribution de vitesse une allure en courbe de Gauss, en cloche, avec donc des objets rapides, qui ... quittent l'amas. Ajoutez l'effet de cisaillement lié à la rotation de l'amas autour de la galaxie. Celui-ci finit par se déformer comme une goutte d'encre jetée à la surface d'un liquide en rotation.
Les collisions entre proto-systèmes solaires communiquent à leurs envelopes de gaz et de poussière un moment cinétique, que ces systèmes conserveront, après que les étoiles se soient dispersées aux quatre coins de la galaxie.
Ce qu'on ignore, mais que j'imagine assez bien, ce sont les phénomènes électromagnétiques intenses qui pouvaient régner dans ces proto-systèmes planétaires, les objets célestres s'électrisant en passant au travers des poussières. Quand le système solaire était en formation, les proto-planètes devaient circuler dans un nuage de poussières et de molécules au sein duquel devaient se produire des orages d'ont l'intensité dépasserait peut être notre imagination.
Dans son article, Jodra suggérait que l'amas primordial, d'où aurait émergé notre Soleil, ait pu contenir une ou plusieurs étoiles massives, à durées de vie brèves, celles-là mêmes qui auraient, telles des spores cosmiques, fourni aux autres proto-étoiles leur cortège de poussières, destiné à former ultérieurement les planètes telluriques. Quand ces étoiles de 20 et quelques masses solaires explosent, bien malin qui pourrait dire ce que deviennent leur noyau de fer. Quand l'étoile SN 1987 A explosa, la seule supernova qui ait pu être observée "de près", dans le nuage de Magellan, un galaxie très proche de la nôtre, son objet résiduel, évoquant deux magnifiques ronds de fumée plongea les astrophysiciens dans la plus grande perplexité. Ainsi, une supernova qui explose peut envoyer dans l'espace... n'importe quoi, y compris des débris de fer de taille importante. L'un aurait très bien pu par exemple, ce me semble, constituer l'actuel noyau métallique de la Terre.
Quelle est la valeur du champ magnétique qui règne au coeur d'une étoile massive ? Il est probablement important, dans la mesure où les pulsars sont considérés comme des coeurs d'étoiles massives mis à nu. Devenus étoiles à neutrons, ces objets tournent rapidement sur eux mêmes. Ils émettent des ondes électromagnétiques. Pourquoi ? Parce qu'un dipôle magnétique tournant rayonne. Si le coeur de fer de l'étoiles massive ne s'est pas mué en étoile à neutron il peut s'être brisé en de nombreux fragments. Est-ce là l'origine des météorites ferreuses ? Le noyau dense de la Terre correspond-t-il à une collision entre une Terre "normale", dont le magma se refroidissait tout tranquillement et un morceau errant de noyau d'étoile massive ? Dans ces conditions, est-ce que le champ magnétique terrestre ne correspondrait pas tout simplement au moment magnétique du bout de fer avalé par la jeune Terre ? Rien n'imposerait alors que ce moment magnétique coincide avec l'axe de rotation de la Terre, mais on peut supposer qu'en interagissant avec le magma les deux spins aient eu tendance à s'aligner.
Tout cela fait beaucoup de "si" et de grain à moudre pour les planétologues. Ce qu'on peut ensuite imaginer c'est que le système solaire puisse avoir été visité de temps à autre par des débris de fer, débris du coeur d'une étoile massive ayant explosé. Ces fragments possèderaient un moment magnétique peut être suffisamment fort pour entraîner, lors de leur passage, le basculement des pôles magnétiques de la Terre, même si les effets de marée liés à la masse relativement faible de ces objets produisaient un effet négligeable sur la planète, en dehors de cette forte altération de sa géométrie magnétique.
C'est à cela que me fait penser ce film montrant l'éruption solaire provoquée par le frôlement d'une minuscule comète : un scénario où l'effet électromagnétique domine vis à vis de l'effet purement gravitationnel, de l'effet de marée.
On connaît le mouvement dit "de précession des équinoxes", découvert par Hipparque au II° siècle avant Jésus-Christ. L'axe de rotation de la terre tourne, décrivant un cône, selon une période de 26.000 ans. C'est ce que ferait un gyroscope dont la vitesse de rotation serait constante. Sont axe décrirait un cône. Ca serait sa façon à lui de réagir vis à vis de l'attraction terrestre, qui tend à placer son axe à l'horizontale. Un gyroscope dont le mouvement de rotation se ralentit s'appelle une toupie. L'axe de rotation de la toupie ne décrit pas un cône mais l'extrêmité mobile de l'axe de la toupie décrit une spirale inscrite sur une demie-sphère. Cette spirale va en s'élargissant, jusqu'à ce que la toupie ne vienne in fine se coucher sur son support.
La Terre possède un renflement équatorial. Cette distribution de sa masse fait qu'elle tend à placer ce bourrelet dans le plan orbital lunaire et dans le plan orbital terrestre. Tout cela interagit à qui mieux mieux et, au bout du compte, les deux plans devraient coincider, de même que tous les plans orbitaux des planètes et satellites, avec le plan de l'écliptique. Comme la Terre tourne elle se comporte comme un gyroscope qui, au lieu de se coucher, tendrait au contraire à se redresser. Si la vitesse de rotation de la terre restait absolument constante, son axe enveloperait un cône. Mais comme celle-ci diminue au fil du temps, non seulement l'axe de rotation terrestre tourne, mais il se redresse, très lentement. Pour avoir une image du mouvement de précession terrestre il faudrait suspendre un gyroscope par un fil, ou le lier à un axe vertical par un cardan, et observer l'image du tout dans un miroir horizontal. On verrait alors le gyroscope tourner et progressement se redresser. C'est une manip qui serait à la mesure d'un club d'astronomie modeste.
Retour vers Nouveauté Retour vers Guide Retour vers page d'Accueil
Nombre de consultations de cette page depuis le 23 décembre 2004 :