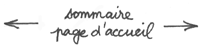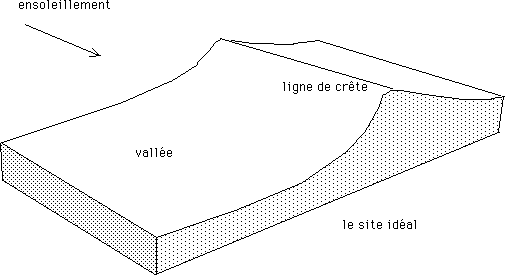
Texte mis à jour le 12 juillet 2007
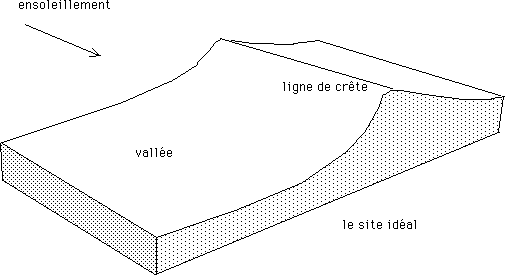
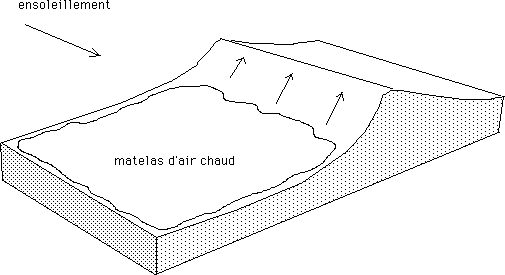
...La falaise, juste en dessous de la crête, est pratiquement perpendiculaire aux rayons lumineux. L'air surchauffé va créer des ascendances qui vont tendre à tirer cette couverture d'air chaud vers les pentes.
..En milieu de journée, le système devient instable.
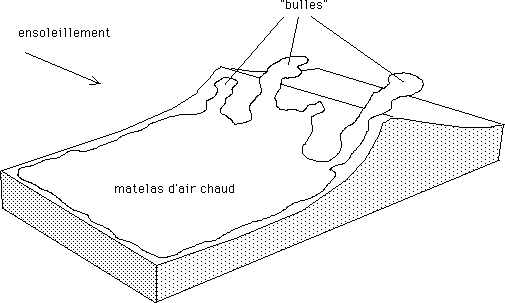
...Sur un fond général ascendant, disons à 1 m/s, due à la montée générale de la masse d'air sous l'effet du vent léger se superposent des "bulles", correspondant à des ascendances plus prononcées (de deux à quatre m/s).
...Les ultra-légers (delta ou parapentes) peuvent jouer sur ce système pour se maintenir pendant des heures en l'air, faire des allers-retour le long d'une crête, puis sauter éventuellement vers un autre "ascenseur", après une "transition", en traversant le plus vite qu'il le peuvent sans trop perdre d'altitude une masse d'air sans ascendance ou légèrement descendante.
...Le mouvement ascendant de l'air peut être plus ou moins régulier. Il peut s'agir de masses assez étendues où les machines sont tranquillement tirées vers le haut. Mais les hasards de la météorologie peuvent donner naissance à un bouillonnement plus intense, à des régions de "cisaillement" où cohabitent, sur des distances de quelques mètres, courants ascendants et descendants.
...Un ultra-léger peut alors traverser une région où règnent des courants aériens très différents :
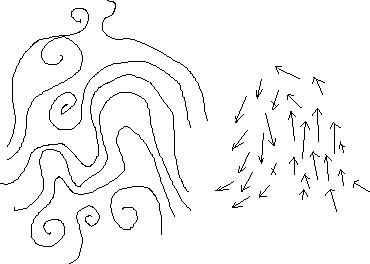
Régions à fort niveau de turbulence. Cisaillement.
...La machine est alors chahutée. Un planeur, qui vole à 120 km/h, s'apercevra à peine de cette turbulence locale, qu'il traversera, rapide comme le vent.
...Un delta verra une de ses ailes se soulever. Le pilote pourra :
- Contrer en projetant rapidement le poids de son corps dans cette direction.
- Tirer sur son trapèze pour accroître sa vitesse et sortir de ce mauvais pas. Sa plage de vitesse est relativement importante : ( 35 à 70 km/h).
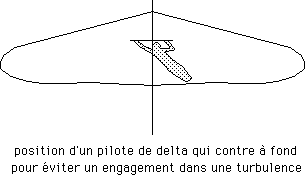
...Toutes les machines ont leurs limites spécifiques, leur "domaine de vol". Sur ce plan on peut comparer les ultra-légers à des bateaux de plaisance et plus particulièrement à des frêles dériveurs, qui ne sont pas conçus pour affronter n'importe quel temps. Disons que le domaine de vol du delta est plus étendu que celui du parapente et nous allons voir pourquoi.
...La vitesse du parapente est beaucoup plus faible. Le pilote ne peut pas piquer, prendre de la vitesse pour sortir d'un mauvais pas, ce que pourra faire un pilote de delta. Mais surtout la voile du parapente n'est pas conçue pour résister à une bourrasque quelconque. Elle va se déformer, se replier, perdre momentanément ses qualités aérodynamiques. Le pilote perdra de l'altitude.
...La déformation peut aller jusqu'à la fermeture. Pour ceux qui ont déjà été témoins d'un tel triste spectacle, la voilure ressemble alors à un mouchoir chiffonné.
...J'ai été témoin d'un tel évènement le dimanche 30 août 98 à 16 heures au site dit "du col Saint Jean", près de Seyne les Alpes. Les conditions étaient apparemment excellentes. Vent du Nord léger (10 km/h). Déclenchement d'un système d'ascendances thermodynamiques (voir schéma plus haut). Ciel bleu, aucune instabilité orageuse.
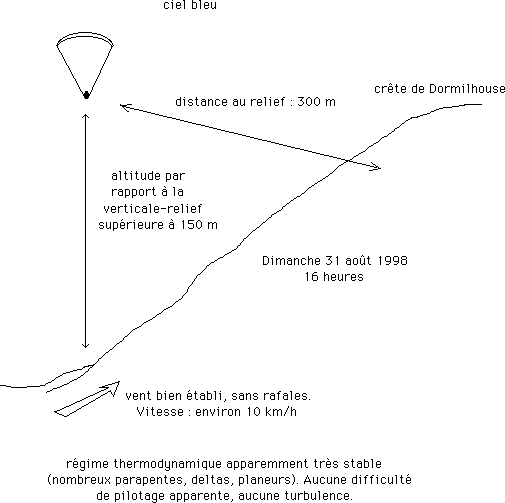
Soudain la voile s'est refermée en "Z" :
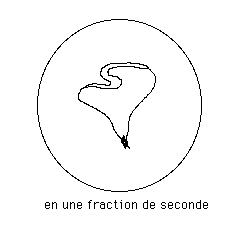
...L'homme a chuté d'une vingtaine de mètres, en criant. Puis la voile s'est rouverte, l'incident ayant duré au total trois secondes.
...Ce type d'incident, si on en croît les pratiquants de ce sport, est monnaie courante, les pertes d'altitude étant en moyenne de 50 mètres.

Incident de vol au voisinage du relief. Le pilote volant
en position assise
son corps se détache au dessus de la tête de la femme en
short qui est au premier plan
Document extrait du manuel de la FFVL.
...Ce type de cisaillement se produit couramment près du sol ou près de reliefs. Dans ce cas le pilote n'a pas le temps de rouvrir sa voilure avant de reprendre contact avec le sol. Il peut être gravement blessé, voire tué.
...Les accident touchent les chevilles, les jambes, le bassin, la colonne vertébrale et correspondent à des chutes verticales.
...Les accidents de delta correspondent le plus souvent à des atterrissages en survitesse (éventuellement vent arrière). Les mains, les bras, les épaules sont alors endommagées.
...Depuis peu la mâchoire est bien protégée par l'adoption d'un casque "intégral" conçu spécialement pour l'ultra-léger. Les trapèzes sont aussi presque tous équipés de roues de vint à trente centimètres de diamètre, qui permettent de rattraper des atterrissages mal négociés.
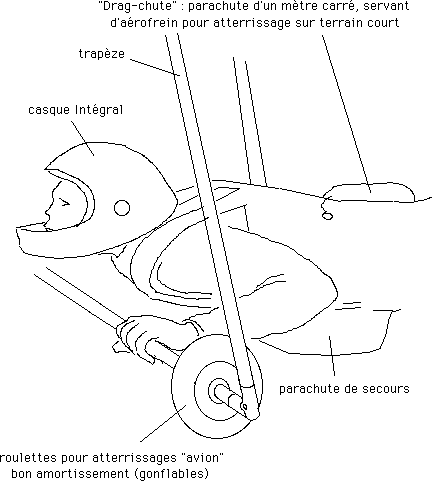
...Je ne veux pas faire de polémique, mais rendre compte de faits. Les voiles des deltas sont solidaires d'un bâti tubulaire, rigide. Les parapentes en sont démunis. On peut comparer ces deux voilures, l'une à la voile Marconi d'un bateau, fixé à sa bôme, l'autre à un spinnaker non tangonné. Tout le monde sait qu'un spinnaker peut s'enrouler à la moindre saute de vent. Il est beaucoup moins stable qu'une voile fixée sur une bôme. Mais quel est le mécanisme type qui entraîne la fermeture d'un parapente ?
...On en est plus au stade des rustiques parachutes à caissons (auxquels on demande, outre de permettre des vols planés appréciables, de pouvoir s'ouvrir en chute libre, ce qui exclut des allongements trop importants). Un parapente est une aile dont le profil est très étudié. Un système complexe de suspentes maintient sa forme. Le bord d'attaque est constitué d'une sorte de grillage souple, à travers lequel l'air pénètre librement, assurant le gonflage des caissons. Tant que le point d'arrêt des filets d'air se situera sur ce tissu-passoire, faisant office d'entrée d'air, la voile gardera sa forme.
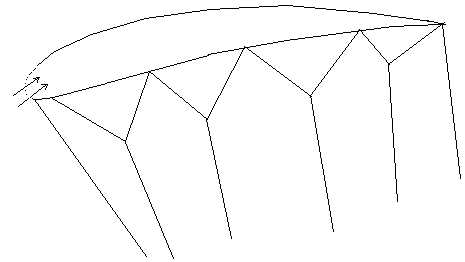
Ci-après, la circulation de l'air dans une utilisation normale :
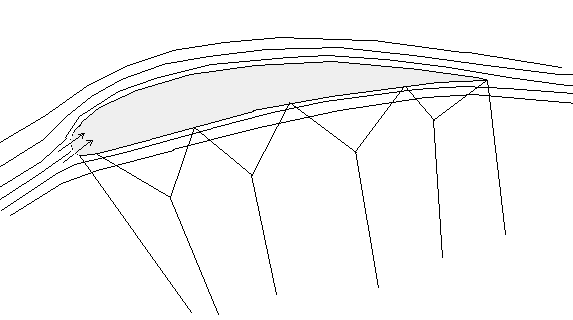
...En grisé : l'air en légère surpression. Mais qu'arrivera-t-il si une turbulence, un "cisaillement" change la direction du "vent relatif", comme ceci :
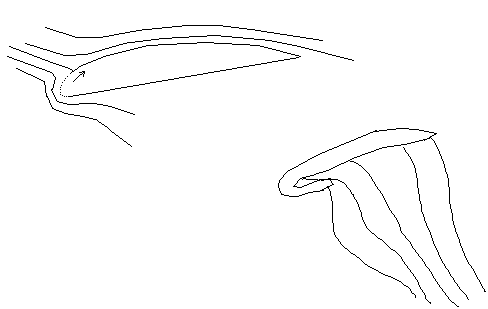
...Cette partie de l'aile se repliera, comme indiqué. Il en résultera une perte immédiate de portance et une tendance au départ en autorotation.
...On voit donc que la configuration dangereuse, pour le parapente, c'est l'incidence faible (comme jadis pour les "Manta"). Or les ailes "performantes", rapides, ont des profils plats et une tolérance étroite quant à l'incidence.
...Quand un libériste veut "faire de la distance" il devra aller d'ascendances en ascendances. Entre deux "pompes" il lui faudra voler le plus vite possible pour effectuer sa "transition". Certains modèles d'ailes "delta" sont équipés "d'overdrives". Il s'agit d'une corde que le pilote peut manœuvre en vol et qui, reliée à un système de poulies, étend sa voilure et l'aplatit. Il accroît ainsi sa "pénétration". Certaines ailes peuvent ainsi frôler les cent kilomètres à l'heure (vitesse maximale). Pour un parapente, c'est exclu. Alors, pour gagner en performance les fabriquants perdent en sécurité.
...La question de la fermeture
en vol des parapentes est développée page 38 et suivant du manuel
de la fédération, chapitre 1.28.2, reproduit ci-après :
1.28.2.Fermetures.
...La
fermeture est le résultat d'une baisse d'incidence. On peu avoir une
idée de ce qui se produit en tirant sur les avants d'une aile gonflée
au sol un jour de vent. D'un certain point de vue, cette capacité de
l'aile à "faire fusible" en cas de rafale brutale est une bonne
chose. On évite ainsi les ruptures dues au stress d'une structure rigide
ou les passages sur le dos de l'aile delta en incidence négative. Mais
ce n'est pas ce qu'on se dit lorsqu'on est à quelques mètres de
la pente, que la moitié de l'aile se referme et que la trajectoire se
met soudain à tourner dangereusement. Certaines ailes sont plus sensibles
que d'autres à la fermeture, sans pour autant qu'on puisse les qualifier
de plus ou moins dangereuses pour cela. Ce qui compte avant tout ce sont :
- La trajectoire suivie en cas de fermeture dissymétrique; une aile saine
ne dévie que de quelques degrés de sa trajectoire; beaucoup d'ailes
modernes à grand allongement ne sont pas saines de ce point de vue, car
elles se mettent en autorotation; le pilote centrifugé be peut s'en sortir
qu'en gardant son sang-froid, freinant et déplaçant son poids
dans la sellette côté opposé à la rotation; une aile
de débutant (exemple niveau 1 ACFPUL) ne se met théoriquement
pas dans de telles situations.
-
La facilité de réouverture : une aile de débutant (niveau
1, toujours) se rouvre théoriquement toute seule; il est cependant conseillé
de l'aider en la freinant (jusqu'à mi-frein à peu près)
du côté opposé à la fermeture, puis de pomper un
ou deux coups brefs sur l'autre commande si l'aile ne s'est pas déjà
rouverte; notons de nouveau l'efficacité de "contrer à la
sellette" enb cas de départ d'un côté ou de l'autre
et le danger, une fois encore, de piloter "à grands coups";
une fermeture n'est pas une catastrophe et la réouverture rarementune
question de vie ou de mort; on doit se donner le temps de réfléchir
à ce qu'on doit faire plutôt qu'aggraver la configuration par une
manoeuvre contre-indiquée.
...Le meilleur remède
contre la fermeture est évidemment préventif. Il suffit de maintenir
les freins enfoncés d'une trentaine de pour cent en permanence pour diminuer
fortement le risque. Les configurations propices à la fermure sont :
- pilote tirant les suspentes avant pour gagner quelques virgules de kilomètres-heure en pénétration (la vitesse air augmente effectivement, mais plutôt vers le bas).
- rafale latérale sur un décollage (fermeture dissymétrique).
- basculement en sortie d'ascendance thermique.
- salut après décrochage dynamique (fermeture symétrique).
- virage serré à vitesse élevée (fermeture dissymétrique côté extérieur).
- vol défreiné dans un vent rafaleux (fermeture symétrique ou dissymétrique)
-C'est évidemment en finale d'approche, juste avant l'arrondi, au moment où le gradient imposerait de voler à vitesse maximale, que la dernière situation se présente. Le plus sûr est de maintenir du freinage, quitte à atterrir un peu brutalement, mais sans surprise.
Fin de citation.
...Une seconde caractéristique du parapente est la façon assez violente avec laquelle il réagit au décrochage. Une aile d'avion décroche, quand l'incidence devient trop forte. Ce peut être dans deux conditions. Soit le pilote vole "aux trop grands angles" soit une rafale ascendante violente provoque ce décrochage. Il y a alors perte de portance. L'aile "salue". En avion ou en delta le mouvement est assez doux (pour peu qu'on le contre au plus vite en rendant la main pour l'avion et en tirant sur la barre pour le delta). J'ai dit plus haut que les premiers delta, les "Manta", ne décrochaient pas, mais passaient en continu d'une attitude de vol normale à une sorte de descente parachutale assez molle. J'ai fait mes premières armes en planeur, à la fin des années cinquante, sur des C 25-S. Ces planeurs, par ailleurs peu performants par rapport à ce qui se faite de nos jours sont réformés depuis longtemps avait la faculté de passer en descente parachutale. C'est dans un C 25-S que de Funès et ses amis s'envolent, dans la dernière séquence du film "La Grande Vadrouille".
...Les parachutes à caisson ou les parapentes réagissent très vivement au décrochage. Sur beaucoup de voiles, un décrochage violent peut amener la voile à la hauteur du pilote et même au-delà. La récupération d'une assiette de vol normale passe alors par un mouvement de pendule qui peut s'avérer dangereux si la machine est très près du sol.
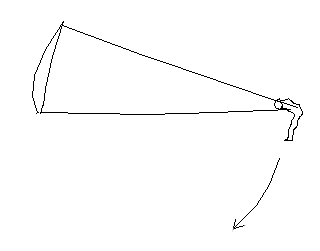
Engagement d'un parapente après un décrochage brutal
...Citons une nouvelle fois le manuel officiel de la fédération, page 37, s'agissant du décrochage d'un parapente :
...Si
on agit franchement, on a l'impression que l'aile s'arrête en l'air, on
pendule vers l'avant, on sent les boyaux remonter vers le sternum, la voile
se met alors à saluer soudainement vers l'avant pour reprendre
de la vitesse. Un débutant, inquiet de cette accélération,
pourra être tenté de freiner. C'est justement ce qu'il ne faut
pas faire dans un premier temps car on va provoquer le même phénomène
: l'aile va monter en chandelle, s'arrêter et repartir dans un nouveau
salut, nettement plus énergique que le précédent, susceptible
de provoquer une fermeture par l'avant. . Il peut toutefois être nécessaire
d'user modérément des freins au cours de l'abattée pour
combattre la sous-incidence et sa conséquence : la fermeture. Ce type
de "second décrochage", dit dynamique, est à
éviter absolument car il rend l'aile totalement impilotable. Il
faut apprendre à ne pas piloter "à grands coups de freins"
mais à procéder par actions courtes et franches.
...L'autre éventualité
est le parachutage bloqué ou stabilisé, encore appelé décrochage
parachutal. En principe, lorsqu'une aile s'enfonce dans sa zone de parachutage,
il suffit de relâcher les commandes pour qu'elles reviennent d'elle-même
aux incidences de croisière. Sous certains modèles mal conçus
ou mal réglé toutefois ceci ne se produit pas. Le pilote enfonce
doucement les commandes, ressent une sorte "d'enclenchement", l'aile
se bloque en vibrant un peu, dans une descente parachutée, selon une
trajectoire presque verticale. Les freins deviennent mous. On peut relâcher
: rien ne change : la situation est stabilisée jusqu'au sol où
à la rencontre d'une turbulence susceptible de rompre l'équilibre.
Une arrivée incontrôlable à des taux de chute dépassant
5m/s n'a rien de réjouissant, aussi faut-il apprendre la manoeuvre de
sortie de parachutal consistant ou bien à enfoncer franchement les deux
freins, afin de provoquer un véritable décrochage, ou bien engager
un virage d'un cote ou de l'autre, ou bien tirer les deux avant (se lever dans
la sellette quand on vole avec cet accessoire). Dans les deux premiers cas l'aile
salue brutalement. On se trouve dans la situation décrite précédemment,
celle d'un décrochage brutal, qu'il convient de ne pas amplifier en freinant
pendant la ressource. La troisième technique n'est pas toujours efficace.
...Ce phénomène
de parachutage bloqué est typique du parapente, mais ne doit théoriquement
pas se produire dans le domaine de vol normal. Toutefois il faut connaître
la manoeuvre de sortie car certaines ailes y sont assez sensibles dans certaines
situations, sortie de virage lent, par exemple, ou à la suite de variations
de caractéristiques de certains matériaux, à l'humidité
ou au vieillissement.
Fin de citation.
...L'allure paisible du parapente en évolution peut donc s'avérer trompeuse. L'extrême facilité de pilotage, de décollage et de poser peuvent faire illusion. Ces machines sont plus délicates à piloter qu'on ne pourrait le penser et requièrent une surveillance de tous les instants. Les facultés de jugement doivent toujours être en éveil, sauf si on vole dans un air parfaitement calme, le matin, de bonne heure, avant que le dieu soleil n'ait mis en marche à la machine à créer des ascendances (et des turbulences).
...Delta ou parapente ? Chacun fait son choix. Le parapente a pour lui l'appréciable qualité de pouvoir être replié, logé dans une malle de voiture. Avec un parapente à la main, on peut faire du stop, avec un delta, c'est exclu. Un parapente peut se poser sur un simple chemin. Son encombrement latéral au sol est faible. Un delta a besoin de plus de place. Mais le domaine de vol du delta est plus étendu que celui du parapente. Il réagit mieux aux fortes turbulences et sur le plan là, c'est une machine incontestablement plus sûre.
...Mais, là encore, tout dépend du type de pratique envisagé. Il existe un "delta extrême", le "vol bivouac", initié par le Suisse Didier Favre :
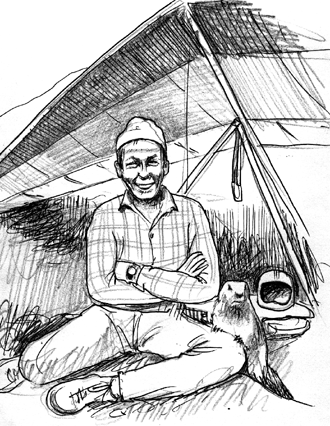
Le Suisse Didier Favre ( décédé )
...Didier était un type extraordinaire, sur tous les plans. C'était avant tout un pilote exceptionnel, qui pratiquait le vol en montagne lequel, s'agissant de l'aile delta, est aussi différent du vol en conditions normales que ne peut l'être la haute montagne par rapport à la randonnée en montagne à vaches. Favre lança une sorte défi, qui consistait à rester en altitude pendant plusieurs jours, sans assistance au sol, en emmenant avec soi tout son matériel de couchage et de camping. L'aile, soigneusement calée par des pierres, servait d'abri. Complété par un sac de couchage, un harnais enveloppant permettait au pilote d'échapper aux rigueur d'une nuit en altitude. Favre pouvait ainsi couvrir pendant ces vols randonnées des distances de quatre cent, ou même cinq cent kilomètres, dans les hautes Alpes. On imagine aisément les conditions de vol et les turbulences rencontrées. Favre avait d'ailleurs raconté ses aventures dans un livre. Ce vol en montagne impose des atterrissages "à contre-pente", pour être à même de pouvoir redécoller le matin, et aussi simplement parce que, dans certains décors, c'est la seule solution pour se poser sur des distances très courtes. Le schéma est le suivant :
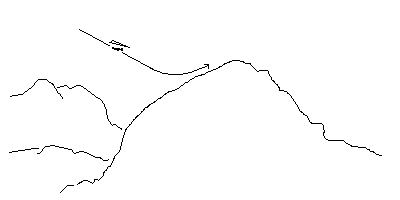
Aterrissage à contre-pente.
...Le
pilote doit donc piquer vers le sol son un angle important, puis redresser juste
au bon moment, ce qui implique un gain de vitesse important. S'il déclenche
trop tard sa manoeuvre il efface sa courte piste. S'il agit trop tardivement,
il s'écrase sur le relief. Il y a un peu plus d'un an, un stagiaire désireux
de s'initier à ce type d'activité connut cette fin brutale.
...L'atterrissage
à contre-pente n'est pas une aberration en soi et fait partie de l'initiation
du pilote de planeur. Mais ceci est alors présenté comme une procédure
de secours, de dernière urgence. En effet un pilote de planeur, navigant
dans une région montagneuse, peut se retrouver piégé dans
une vallée étroite. L'atterrissage à contre-pente, sur
un alpage, peut alors se présenter comme l'unique alternative à
un crash au fond de gorges étroites. Lorsque je faisais du Vol à
Voile à la Montagne Noire, cet exercice faisait partie de l'initiation
générale.
Les risques du tumbling.
...Le vol delta en montagne représente
le vol extrême. Encore une fois, la machine atteint ici les limites de
son domaine de vol. Nous avons insisté plus haut sur les dangers liés
à la pratique du parapente, machine au domaine de vol assez étroit.
Après que le danger lié à la possibilité de "mise
en drapeau" des delta ait été éliminé, il reste
une dernière configuration extrêmement dangereuse : c'est le passage
dos. Celui-ci peut se produire dans différentes conditions, par exemple
lorsqu'un pilote approche de trop près un nuage en train de se transformer
en cumulo-nimbus (phénomène qui se signale aisément à
cause de la couleur sombre que prend la base du nuage et du renforcement des
turbulences. Ces dernières peuvent alors saisir la frèle machine
et la retourner comme un fétu. Le remède est évidemment
de s'abstenir de voler dans de telles conditions, suicidaires.
...Certaines configurations du relief se prètent
à une aérologie particulièrement vicieuse, avec présence
(évidemment invisible) d'un "rotor". Une falaise surplombante
pourra, si le sens du vent est celui qui est indiqué; produire ce type
de configuration.
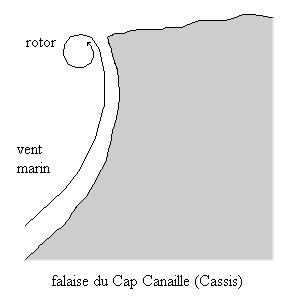
Un exemple de rotor ( extrêmement dangereux ).
...Si un delta s'aventure dans
ce rotor, sa machine peut, avant même qu'il n'ait esquissé un geste,
être retournée, le pilote partant alors dans la structure. Bien
qu'était en principe certifiée pour un certain nombre de "g"
négatif (quand elle est neuve) la machine peut alors se briser et il
restera au pilote le dernier recours de tenter de faire usage de son parachute
de secours, démarche bien problématique s'il se débat dans
un fouillis de tubes brisés et de câbles, de plus à basse
altitude.
...Didier Favre était évidemment
un fin connaisseur en matière d'aérologie. Pourtant il finit par
se tuer il y a quelques années. Lors d'un vol en montagne? Pas du tout
: en essayant un prototype d'aile rigide inventé par un ami (...).
...Dans la course à la performance, certains ont fini par transformer les ailes des "delta" en véritables ailes de planeur ultra-léger. L'allongement devient alors très important. Les profil d'aile est complet, la double surface s'étendant sur pratiquement toute la corde, si on excepte un système d'hypersustentateurs arrière. Le montage est laborieux, un système complexe de lattes donnant sa forme à l'ensemble de l'aile, qui n'est pratiquement plus déformable. On sort alors de la formule delta, dont la maniabilité est précisément due au caractère déformable de sa voilure. Cliquer ici pour plus de détails sur ce point. Le problème est alors de rendre pilotable une telle machine, dépourvue d'empennage. La solution, mise en oeuvre il y a déjà plus de vingt ans, consiste à disposer en bouts d'aile des "aérofreins", surfaces mobiles autour d'un axe, qui permettent, en les opposant au sens du vent relatif, de créer une trâinée, donc de déclencher un virage.
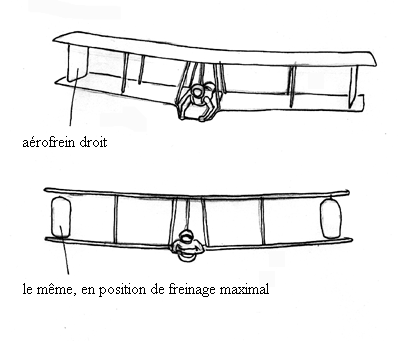
aile rigide avec aérofreins.
...C'est ce type de machine de Didier essaya, en décollant d'une falaise. Mais son ami inventeur avait omis de tester la résistance de sa machine, au cas où les deux aérofreins étaient braqués à fond simultanément, ce qui est une manoeuvre normal pour "casser la vitesse". Cela aurait été possible en fixant simplement l'appareil sur une fixe au toît d'une voiture et en roulant à cent kilomètres à l'heure. Favre n'avait pas atteint cette vitesse quand il déclencha cette manoeuvre de freinage. L'aile se rompit instantanément. Volant à trop basse altitude il n'en pas le temps de faire usage de son parachute de secours.
...Encore un constructeur désolé.
A la page 157 du manuel de la fédération de vol libre on trouve la phrase ci-après :
...Heureusement pour les libéristes, un statut relativement souple a été négocié, sur le principe de l'autodiscipline, c'est à dire que nous, usagers, proposons à l'administration de respecter certaines règles de conduite, en échange de quoi celle-ci accepte de nous faire confiance dans de nombreux domaines traditionnellement très contrôlés, et ne nous soumet pas à un système harcelant de contrôle permanent.
et, un peu plus loin :
...L'autodiscipline du vol libre à la française mise sur le sens des responsabilités de chaque pilote, des clubs, des écoles et des fabriquants.
Fin de citation.
...Certes, Favre et son
ami étaient de nationalité Suisse et non française. Cet
accident soulève le problème de la certification, de l'homologation
des ultra-légers. Dans ce cas précis, la faute était flagrante
: la machine avait été soumise à des essais en vol avant
même d'avoir subi des essais statiques aux efforts. Mais qu'en est-il
dans l'hexagone?
Seuls les constructeurs de parapentes se sont regroupés, en liaison avec
la FFVL (Fédération de Vol Libre) pour crér l'homologation
ACFPUL. Voir l'ouvrage de la fédération, page 186 :
5.21
Le matériel
.......5.21.1 L'homologation ACFPUL
.............Dans de
nombreux domaines de l'Aéronautique l'Etat impose des "critères
de "navigabilité" aux aéronefs utilisés. Ainsi
un fabriquant de planeur, avant de mettre un nouveau modèle dans le commerce,
doit suivre une longue procédure (dossier de calcul, essai de charge
jusqu'à la rupture, essais en vol, passage au Centre d'Essai en Vol de
Brétigny) et montrer que l'atelier où l'appareil est fabriqué
répond lui aussi à certaines normes. Ce système est très
lourd, donc très coûteux en bout de chaîne, pour le client.
...En vol libre, par chance, rien de tel ne nous est imposé (...).
Fin de citation.
...Quand
on lit de telle phrases il est bon de savoir qui en est l'auteur. L'ouvrage
"Le Manuel du Vol Libre. Fédération Française de Vol
Libre" a été conçu et rédigé par Hubert
Aupetit, avec le concours de la Commission Enseignement de la Fédération.
En clair : tout ce qui est écrit dans cet ouvrage porte l'estampille
de la fédération. Mais reprenons la citation de ce passage de
l'ouvrage, consacré au problème de l'homologation.
...Mais cette faveur n'est qu'apparente. Quand bien même l'administration de l'Aviation Civile le voudrait, il lui serait très difficile dans l'état actuel des connaissances techniques sur les planeurs ultra-légers de définir un programme approprié.
...Tous les libériste, les représentants de la fédération et les constructeurs vous affirmeront que les planeurs ultra-légers (et par extension les ULM) n'ont rien à voir avec les planeurs ou les motoplaneurs classiques. De ce machines,disent-ils "nous ne savons rien. Il serait donc totalement vain qu'un service technique se penche sur le problème". Pourtant, quand le constructeur des premiers Manta en France qui n'avait rien d'un ingénieur, ou même d'un technicien, avait été confronté avec des problèmes de câblerie, en particulier ceux qui reliaient le point de jonction bord d'attaque transversale au trapèze (et dont la rupture mettrait immédiatement la machine en perdition) il les avait résolu d'une manière assez originale. Ayant sans doute des problèmes de corrosion avec ses câbles, il est avait gainés d'un jolie plastique jaune.
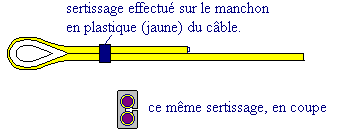
dessin des câbles inférieurs et du sertissage.
...Le
bout du câble s'enroulait autour d'une cosse, puis les deux brins étaient
rendus solidaires à l'aide d'une pince à sertissage. Détail
: ce sertissage était opéré non sur le câble, mais
sur le ... plastique. Mais probablement était-ce normal. L'ultra-léger,
c'est très spécial. On ne saurait comparer ses structures à
celles de machines déjà existantes.
...Certains
s'écriront "oui, mais c'était il y a vingt-cinq ans, à
l'époque héroïque. Tout cela est révolu, maintenant
!".
...Pas si sûr. Il y a peu d'années je me suis trouvé sur les lieux où venait de se produire un accident mortel d'ULM. Le pilote, un moniteur du Centre Otto Lilienthal, près de Laragne, dans le sud de la France, ainsi que sa passagère, avaient fait une chute mortelle. Un représentant de l'Aviation Civile avait été appelé, pour une enquête de routine, et s'apprétait à conclure "accident pour cause indéterminée". Visiblement l'affairte ne l'intéressait pas le moins du monde et il avouait ne rien connaître à l'ultra-léger. Les gendarmes de l'air avaient ramassé, en vrac, les débris de l'appareil et les avaient entreposés dans un garage. Incompétents, ils avaient été incapables de tirer la moindre information de ceux-ci.
...En examinant l'épave j'ai pu constater que je pouvais déchirer le Dacron de la voilure à deux mains. Elle s'était rompue en vol au niveau du bord de fuite, provoquant une chute immédiate, bord de fuite qui n'était renforcé que par un simple ourlet. Y loger un solide fil de Nylon aurait renforcé ce point faible de la machine. Par ailleurs, comment se fait-il que l'entoilage d''une machine utilisée pour l'enseignement ait pu se déchirer ainsi en vol, en étant cuite par le rayonnlment ultra-violet? Comment se fait-il qu'on trouve encore sur les terrains d'aviation des planeurs et même des avions dont certaines parties des ailes sont encore entoilées? ...Pourquoi ces toiles-là, qui passent tout leur temps en plein soleil, n'explosent-elles pas en vol?
...Elles font simplement l'objet de contrôles périodiques. On utilise un pénétromètre. C'est un objet assez simple :
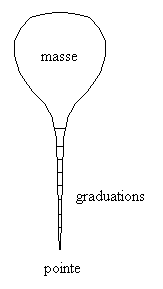
pénétromètre
...Il est gradué. Sa profondeur de pénétration permt de mesurer l'état d'affaiblissement de l'entoilage.
...Les
fabriquants d'ultra-légers ignorent l'existence de cet appareil, qui
fait doute partie de ces "contrôles lourds que l'on voudrait nous
imposer". On peut aussi s'interroger sur la qualité des Dacrons
avec lesquels certains fabriquants peu scrupuleux entoilent leurs appareils.
Mais si on voulait s'assurer que ceux-ci sont de bonnes qualité, il faudrait
introduire des normes de fabrication, "emprisonner cette construction dans
un carcan de contraintes administratives".
...Il
ne s'agit pas de delta ou de parapente, mais d'ulm. Ceci étant, tous
les trois ont des voilures en tissu synthétique. Sur le dessin ci-après,
inspiré des photos prises par la Genarmerie de l'Air, on voit que la
voilure de l'aile delta de ce "pendulaire" s'est déchirée
sur toute la longueur de son profil. Dans ces conditions, le parachute de secours
restait le seul recours du pilote. Mais pourquoi ces ailes, qui sont soumises
à des charges importantes, ne sont-elles pas renforcées, sur leur
bord de fuite, par un solide galon de nylon ?
...Revenons
aux années soixante, quand les parachutes étaient encore de forme
"hémisphérique". Selon la formule initiale "voilure
d'abord" (par opposition à la solution "suspente d'abord",
qui intervint pas la suite, avec les parachutes à gaines) les voiles
subissaient des chocs importants à l'ouverture. Les clubs civils étaient
pauvres. J'avais fait mes premières armes au club de Bourget du Lac,
en 61, après quelques saut effectués à la Ferté-Gaucher
en 59, en tant qu'étudiant de Supaéro. Les militaires n'avaient
pas de clubs de parachustime sportif. Ils "payaient" donc les clubs
civils en leur fournissant de l'essence et quelques vieux parachutes. Il arrivait
que certains éclatent à l'ouverture. J'ai connu personnellement
ce type d'incident, une fois. Alors un parachute hémisphérique
se transformait spontanément en "parachute à fente".
Fort heureusement cette fuite d'air n'accroissait pas beaucoup la vitesse de
descente.
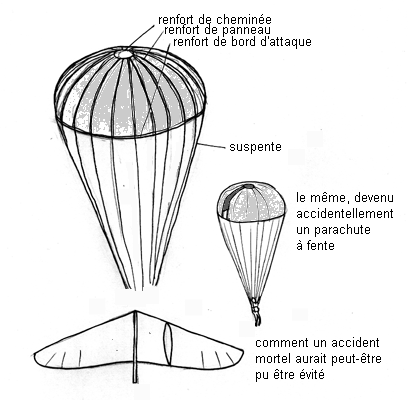
...Comme on peut le voir sur le dessin, le galon de renfort, de 15 mm de large, empêchait l'éclatement complet. Cousu sous la voilure de l'aile delta d'un ULM (donc au passage protégé des UV) il aurait pu sauver la vie des deux passagers. Cela ou un fil de nylon épais, logé dans l'ourlet.
...Je repris mon examen des débris. Un des gendarmes avait retrouvé un objet d'aluminium à deux cent mètres du crash, dont il n'avait pas compris la fonction. L'homme de l'Aviation Civile (visiblement agacé et pressé), non plus. J'identifiai la fusée pyrotechnique d'extraction du parachute de secours. Le lacet qui la reliait au parachute, dont les photos prises par les gendarmes montrèrent qu'il n'était pas sorti de sa gaine, s'était rompu.
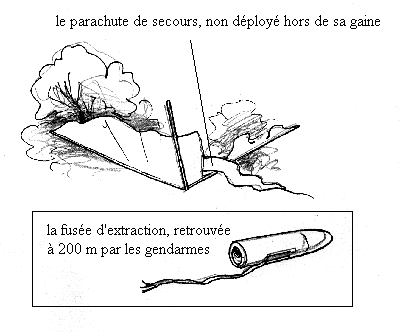
Or ces systèmes d'extraction, très brutaux (pour être suffisamment rapides) sont reliés au parachute par un lacet, à travers un système assurant un amortissement du choc.
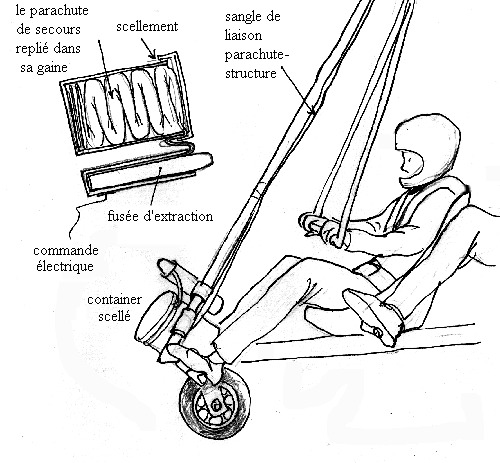
Parachute à extracteur pyrotechnique.
...Classiquement, on utilisait une sangle cousue sur elle-même, en "Z". La déchirure d'une couture est en effet un assez bon moyen d'absorber un choc. Ces parachutes, de fabrication Américaine, étaient enfermés dans des containers emplis d'argon, scellés par un cordon de polyéthylène. Impossible don, de contrôler périodiquement ce dispositif de secours, ni même de voir si, à l'achat, il pouvait être conforme à la notice technique qui l'accompagnait. Je retrouvai celle-ci, qui faisait mention d'un amortisseur à déchirure, mais l'examen du parachute montra que le système était complètement différent. Le constructeur avait utilisé des fils de caoutchouc, entermés dans un tube de Nylon, souple. Le caoutchouc avait vieilli. La notice ne spécifiait pas la longévité de ce dispositif de secours, par ailleurs fort coûteux (dix à vingt mille francs). L'amortisseur n'avait donc pas fait son office, le lacet de jonction s'était rompu et le parachute ne s'était pas ouvert.
...Des
histoires comme celle-là, je pourrais vous en conter des douzaines. Ce
qui est important dans l'extrait du livre de la fédération que
je viens de citer, c'est cette dénégation de toute expérience
qui pourrait être issue de sphères extérieures au monde
de l'ultra-léger. Et il ne s'agit pas que des matériaux. Apparemment,
les ultra-légers échapperaient aux lois de l'aérodynamique
conventionnelle, il serait vain de tenter de les enfermer dans des souffleries,
sous forme de maquettes, ou des procéder à des essais en vol de
prototypes télécommandés, à échelle réduite.
...Au
plan des connaissances techniques et de mécanique des fluides, les concepteurs
d'ultra-légers en sont au stade où en étaient les avionneurs
du début de ce siècle, c'est à dire à celui de m'empirisme
le plus complet. Vous comprenez maintenant pourquoi on trouve des concepteurs
d'aéronefs ultra-légers qui envisagent de construire leurs appareils
avec des échelles en alu. Vous ne trouverez en France aucun constructeur
d'ultra-léger qui ait fait des études d'aéronautique, qui
connaisse la mécanique des fluides, la résistance des matériaux.
Voilà pourquoi on ne dépose pas de dossier-calcul, l'astuce consistant
à abriter cette incompétence en prônant l'extrême
originalité de ces appareils, qui semblent ainsi échapper à
toute étude technique classique. Vous comprenez maintenant pourquoi ces
engins n'ont pu progresser que par un système "essai-erreur".
Mon ami Michel Katzman et son passager-client sont morts pour faire progresser
la technique, révéler que les "pattes à trous"
des delta étaient d'épaisseur légèrement trop faible.
Ce moniteur et sa passagère sont morts (en vain) pour rappeler que les
matériaux utilisés pour la construction de voilures d'ultra-légers
devaient faire l'objet à la fois de contrôles très stricts
au stade de la fabrication, et de contrôles périodiques. Je me
souviens de cette petite fille de dix ans qui errait dans le Centre Otto Lilienthal,
quelques jours après la mort de son père, divorcé, qui
l'avait prise avec lui pour quelques semaines de camping, et dont nous essayions
en vain de joindre les grands-parents. Les gens qui, au nom de la sauvegarde
d'une sacro-sainte liberté, d'un romantisme imbécile ou d'un fantasme
libertaire veulent maintenir la situation atcuelle (l'auto-discipline chez les
constructeurs) sont des dangereux irresponsables, des meutriers qui s'ignorent.
A moins que cette situation ne profite à des fabricants peu scrupuleux,
qui peuvent ainsi accroître leur marge bénéficiaire en équipant
leurs machines de voilures fabriqués avec du Dacron de mauvaise qualité,
des acastillages n'ayant pas "la qualité aéronautique",
des boulons travaillant sur leur filetage, parce que non conçus spécialement
pour la machine, par économie ("c'est plus commode, comme ça
on utilise les mêmes boulons pour toute la machine"). A moins que
cela ne permette à des importateurs, parfaitement conscients de ce qu'ils
font, d'acheter au rabais des machines interdites de vol dans un pays étranger
et de les revendre à des français. Une histoire qui fit de nombreux
morts. La DGAC délivra au passage une immatriculation à ces appareils
(qui n'est absolument pas, suprème dérision, un certificat de
navigabilité). Mais pourquoi cet importateur d'aéronefs interdits
de vol dans un autre pays se serait-il interdit de racheter ce lot de machines
et d'en tirer bénéfice dès lors qu'aucune réglementation
française ne pouvait lui interdire de le faire, du fait de la démission
de la DGAC face à ses responsabilités.
...Des douzaines de souvenirs me reviennent en
mémoire, qui me tordent le coeur. A Trets, près de chez moi, s'était
montée une école "modèle". Un de mes amis, ancien
pilote de Mirage III, y était moniteur, sur des biplaces côte à
côte. Le siège était boulonné sur la structure. A
chaque atterrissage les deux boulons subissaient un effort en cisaillement.
Un jour l'un d'eux se rompit en l'air. Pilote et élève se retrouvèrent
assis sur les câbles commandant leurs gouvernes, ce qui rendit immédiatement
l'appareil impilotable : deux morts.
On ne calcule pas, quand on aime.
...Le
fabriquant mit des boulons plus gros. Et même si ce fabriquant-là
avait été incapable de calculer l'effort subi lors de chaque atterrissage
par ses boulons, qu'est-ce qui l'aurait empêché, dans un hangar,
de tester sa cellule en imaginant un dispositif qui aurait, un grand nombre
de fois, soulevée par exemple celle-ci à un mètre ou deux
de hauteur, en la lâchant sur le béton, lestée de deux sacs
de quatre-vingt kilos ? Il n'y a pas que les calculs, il y a le bon sens, la
méthode et le simple respect de la vie humaine.
Un jour, Katzman et moi avions trouvé, dans le hangar du Centre Otto
Lilienthal, un homme qui avait construit un chariot d'ULM de sa conception.
Michel et moi, nous nous étions assis dans sa merveille et nous nous
étions mis à sauter dans nos sièges. Très vite,
le train s'affaissa.
- Vous avez cassé mon prototype !
- Ecoutez, soyez sérieux. Si deux bonsommes arrivent à effondrer
votre chariot dans un hangar, simplement en sautant dans leurs sièges,
que se passerait-il lors d'un atterrissage un peu brutal?
...Celui-là était... luthier.
...Après cette digression, revenons à ces problèmes d'homologation. L'ouvrage d'Hubert Aupetit nous apprend qu'il existe une homologation professionnelle pour les parapentes, dont il est précisé, page 187, qu'elle a été agréée par l'AFNOR sous la norme S 52 308/309. On lit :
"L'homologation ACPUL (ou AFNOR) donne deux types de tests : résistance à la rupture et épreuve en vol. Aucune simulation numérique ne peut, à l'heure actuelle, donner des garanties quant à la navigabilité et à la solidité des ailes souples".
...Pourquoi
diable la navigabilité et la solidité des ailes souples relèverait-elle
de simulations numériques ? Les problèmes de la stabilité
en vol, des l'aéro-élasticité et de la fatigue des matériaux
ont été découverts et maîtrisés bien avant
l'apparition de l'ordinateur. Cette phrase n'est qu'un artifice pour justifier
l'absence d'études sérieuses, en soufflerie, ou sur maquettes
técommandées, des études que l'Ecole Supérieure
de l'Aéronautique (voir le projet Laroze-Petit, évoqué
plus haut, qui pourrait être étendu à l'échelle européenne
avec mise en commun de moyens technique de différentes écoles
d'aéronautique) était prête à faire gratuitement
il y a dix ans (il se serait agi de de simples travaux pratiques pour élèves
de première année), à condition qu'un thésard puisse
encadrer ces travaux (et c'est là que nous nous étions heurtés
au refus de la DGAC de financer un tel projet, en l'occurence une bourse d'ingénieur-docteur,
soit 250.000 Fr sur deux ans, alors que la FFVL était prête à
l'époque à y contribuer).
...Ceci
étant, il était relativement facile de produire des normes, pour
les parapentes, si on laisse de côté épineux de leurs problématiques
qualités de vol, en s'inspirant de ce qui existant déjà
dans le monde du parachutisme, concernant voilure, sanglerie, suspentes. Mais
cela s'arrête là.
...Je me souviens au passage au début de ma carrière de chercheur avoir participé, à l'Institut de Mécanique des Fluides de Marseille, à des études effectuées en soufflerie sous la direction de l'ingénieur Pencker, sur des maquettes, et qui concernait l'ouverture de nouveaux parachutes, preuve que le comportement des voilures déformables ne relève pas automatiquement, comme semble le suggérer Aupetit, de "simulations numériques".
Toujours page 187, on lit :
...Les tests en vol sont effectués par des pilotes d'essai de grande expérience équipés de parachutes de secours et évoluant au dessus de surface aquatiques.
...Je sais qu'il s'agit de l'ulm, en fois en cours (où le dossier est alors fort lourd, et pas seulement à cause d'histoires remontant à des années. Il existe des machines qui mettent la vie de leur possesseurs en danger, alors que ceux-ci sont complètement ignorants de ce danger, et qui sont toujours en circulation). Après avoir placé sur le site de Germain (gegair) un premier article (qui m'avait valu des lettres d'insulte et des menaces) j'avais reçu un appel téléphonique d'un testeur de parachute de secours, lequel opérait lui aussi au dessus de surfaces quatiques et qui m'avait dit en substance :
- J'ai
resté récemment deux parachutes de secours à ouverture
pyrotechnique, au cours d'un même vol sur un ulm. Ils ont tous les deux
éclaté à l'ouverture.Ces matériels ne valent rien,
tout le monde le sait. C'est de l'argent fichu en l'air et il y a de plus en
plus de gens qui décident de s'en passer.
- Seriez-vous prêt à témoigner de cela sur le site ?
- Non, je perdrais mon emploi de pilote d'essai.
...Après cette nième digression, revenons à cette histoire d'homologation des parapentes, selon cette "norme AFNOR" (manuel FFVL page 187) :
...Le premier système d'homologation de l'ACPUL était prédictif. Il classait les ailes en trois niveaux, correspondant à des types de pilotages de plus en plus exigeants. Ainsi le premier niveau s'adressait aux pilotes peu ou pas formés, mal informés de la turbulence et de ses effets. En conséquence, une aile de niveau 1 devait pouvoir "ramener le cavalier toute seule à l'écurie" :autrement dit être en mesure de redresser par elle-même en toute situation de détresse. Mais les machines ont évolué (...), les domaines de vol se sont agrandis (...), les phénomènes observés sont devenus de plus en plus complexes (...). Les constructeurs ont préféré définir une règle plus souple (...) donnant des notes à l'aile pour son comportement dans les principales configurations de vol. L'homologation est devenue essentiellement informative. C'est à l'acheteur, informé par le cartouche du fabriquant, résumant toutes les prestations du modèle, d'exercer son libre arbitre en fonction de son propre niveau de pilotage, et, bien sûr, de ses goûts.
Fin de citation.
...Au passage,une remarque que me suggère mon ami Jacques Legalland, grand vélivole, pionnier en matière d'ultra-léger et ancien responsable de l'équipe de France de delta :
- Il existe dans l'ultra-léger en général, et dans le parapente, un important marché de l'occasion ou les aéronefs sont revendus bien évidemment sans contrôle technique. Les champions de parapente voudront avoir la machine la plus performante, le dernier cri. Donc ils ne garderont pas ces machines si délicates qu'eux seuls devraient être habilités à piloter. Ils ne pourront pas les revendre à leurs pareils, qui rechercheront eux aussi les engins les plus récents. Donc ils les cèderont à des pilotes d'expérience intermédiaire, lesquels, lorsqu'ils voudront changer d'aile, revendront à bas prix ces machines à des ... débutants.
...Voilà donc ce qu'il reste de cette homologation des parapentes : la garantie qu'ils n'exploseront pas dès leur premier vol, que les suspentes ne se rompront pas et que vous ne passerez pas au travers de votre sellette, les coutures ayant été réalisées dans les règles de l'art. Quant au reste, c'est votre affaire. Le risque à la carte, en quelque sorte.
...La certification des ailes delta repose sur une unique donnée. Les constructeurs se sont mis d'accord sur le fait que pour pouvoir être mise en circulation, les ailes devaient pouvoir résister à des facteurs de charge de + 7 g en positif et - 5 g en génatif. Ces essais sont réalisés sur un banc d'essai roulant (un élément moteur de semi-remorque) ou en chargeant les ailes avec des sacs de sable. Aucun test n'est effectué concernant la résistance des composants à la fatigue. S'agissant des ailes delta non motorisées, une certaine expérience a fait que les fabriquants, grâce évidemment à un nombre impressionnant d'accidents mortels en 25 ans ont pu converger vers des machines relativement robustes, conjuguant performances et qualités de vol acceptables, par simple empirisme, et non à l'aide d'études systématiques. Mais prétendre fonder la certification d'aéronefs sur la simple base d'essais statiques effectués sur des machines sorties d'usine en ignorant le phénomène de fatigue ferait sourire, ou provoquerait une indignation légitime chez tout ingénieur spécialisé dans la construction de matériels volants. Certaines ailes delta motorisées, soumises à des charges beaucoup plus importantes, recèlent des vices de construction d'une extrême gravité. Mais comme nous évoquons ici des éléments se référant à un procès en cours, nous ne pourrons en dire plus, sous peine d'invalider la procédure.
...A la fin de l'ouvrage "Le Manuel du Vol Libre", émanant de la Fédération Française de Vol Libre, on trouvera des "recommandations", qui font le pendant à celles de la DGAC, lesquelles sont reproduites dans le manuel page 160 et suivantes. Les voici :
V.Recommandations
concernant le matériel volant.
Dans l'attente de la diffusion de la réglementation
en cours d'établissement (...) relatives aux conditions administratives
et techniques à respecter pour la construction industrielle ou amateur
(...) des planeurs ultra-légers, il est instamment recommandé
:
1 - d'entretenir régulièrement le matériel.
2 - de s'assurer de la conformité technique des pièces de rechange
avec les pièces d'origine.
VI. Recommandations
relatives à l'utilisation des planeurs ultra-légers.
1 - Les utilisateurs doivent avoir une conscience claire
de leurs propres limites et de l'appareil qu'ils utilisent (...). ainsi qu'une
bonne connaissance des phénomènes aérologiques.
Il est recommandé en conséquence à qui veut pratiquer le
vol libre de pratiquer recevoir une formation ou une initiation appropriée.
Par ailleurs il convient de préciser qu'une fédération
française de vol libre a pris l'initiative de définir et de préconiser
une méthode et une progression d'enseignement et de former des moniteurs
dont elle a établi une liste. Cette fédération est placée
sous la tutelle du Secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux Sports
qui habilite la seule FFVL à délivrer des titres de compétence
pour l'exervice du Vol Libre et le monitorat.
2 - Pour prévenir les accidents ou les dommages corporels consécutifs,
il peut être recommandé à tout élève ou pratiquant
confirmé :
- de disposer d'un équipement individuel de protection comportant notamment
un casque et des gants.
- d'effectuer une visite pré-vol minutieuse avant le sanglage
- de ne pas effectuer de vols par un vent supérieur à 10 m/s ou
dont les variations de vitesse soient supérieures à 2m/s
- de n'utiliser que des sites et des matériels éprouvés
par l'usage et par des pratiquants très confirmés.
Essayez d'imaginer un court instant une phrase du genre :
- Dans la pratique de la moto, le Ministère des Transport et la Gendarmerie Nationale recommandent le port du casque et le respect des limitations de vitesse suggérées sur les panneaux routiers à leur intention....
Ces recommandations de la DGAC sont reprises page 188 au chapitre des "recommandations fédérales". On lit en particulier :
-
l'emport d'un parachute de secours est recommandé pour tout type de vol
en delta
- le port du casque est recommandé pour tout type de Vol Libre, obligatoire
dans les écoles agrées, sur les sites agréés et
dans les compétitions fédérales.
La FFVL recommande aux libéristes de ne pas dépasser des assiettes
et des inclinaisons de 45°.
...Il existe des pilotes qui vivent en donnant des baptèmes sur des delta biplaces, qu'ils soient motorisés ou non. Mon ami Katzman s'est tué parce qu'il avait pas, fixé à son harnais, de parachute de secours. Son client est mort avec lui. Il est étonnant que ni la DGAC, ni la Fédération n'exigent le port de casques et l'emport d'un parachute pour ce type d'activité.
...A titre de commentaire, sur le dernier point, nous nous contenterons de reproduire trois photographies illustrant ce manuel, situées respectivement aux pages 41,126 et134.
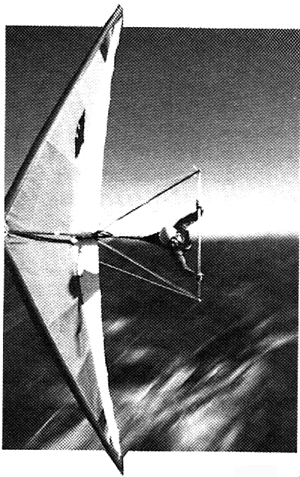 |
 |
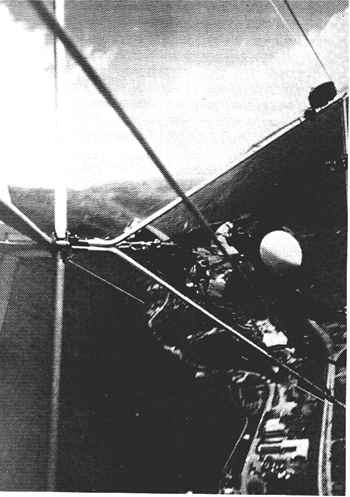
...Si vous avez des remarques à formuler ou des témoignages à nous communiquer, vous pouvez le faire sur mon e-mail ..Mais sachez qu'alors nous nous donnerons alors le droit de les reproduire dans ces colonnes. En effet, dans autre site, nous avions reçu des témoignages, en particulier de victimes d'accidents, émanant entre autre de moniteurs ou de testeurs de machines qui nous avaient demandé de ne pas les publier "de peur de perdre leur emploi". Nous avons reçu aussi beaucoup de lettres d'insultes, voire de menaces, qui nous ont laissé indifférents.
...Nous continueront cette enquête en développant, preuves à l'appui, le cas de l'ULM où la situation est alors franchement inquiétante. Il subsiste des problèmes, graves, que seule une décision d'ordre politique pourrait résoudre. Nous sommes à la recherche d'un élu qui souhaiterait intervenir en ce sens et nous serions alors prêt alors à lui fournir tous les renseignements techniques qui lui permettraient d'orienter son action.
Ci-après : un extrait de la réglementation DGAC (Délégation Générale à l'Aviation Civile).
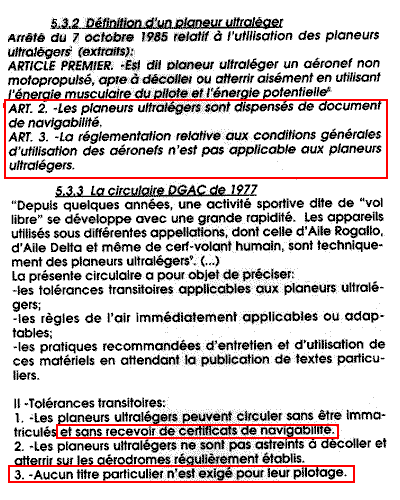
Tribune Libre
22 avril 2000. message émanant de Mr. François Sieklucki :
...Je ne suis pas en avance pour
découvrir votre article passé dans le site gegair en 1998 mais ce dernier m'a
beaucoup intéressé par sa clarté et sa simplicité ; je ne manquerai pas de m'y
référer pendant les cours de formation aux élèves pilotes paramoteur et aux
instructeurs stagiaires. Nous avons sensiblement le même âge : mes débuts dans
le parachutisme remontent à 1958 et j'ai été instructeur jusqu'à ce que j'arrête
de sauter en 1995 ; j'ai fait un peu de delta en 1981 et du parapente depuis
86. Par ailleurs je suis PP. IFR bimoteur et depuis 1990 instructeur paramoteur
(1er vol en 1988). Cela étant dit, je partage votre avis sur tous les points
techniques que vous évoquez et j'aurais bien du mal à ne pas être d'accord avec
vous compte tenu de vos références scientifiques. Par contre je ne vous rejoins
pas complètement dans votre philosophie sécuritaire, voire répressive, de la
pratique du vol libre et de l'ULM. Si ce que vous dites était vrai le nombre
d'accidents comparé entre l'ultra-léger et l'avion devrait être en faveur de
l'avion (à HdV égales bien sûr) et ce n'est pourtant pas le cas lorsque l'on
compare les statistiques du BEA que les districts reçoivent chaque mois. Vous
citez des structures comme le parachutisme qui peuvent imposer telle ou telle
obligation, et je ne pense pas que ce soit un bon exemple lorsque l'on voit
la majorité des gens sans casque, tongs aux pieds, les virages de la mort qui
ont remplacé les ouvertures basses de notre époque et enfin la possibilité de
faire des milliers de sauts sans avoir de connaissances théoriques sanctionnées
par un examen (sauf brevet C avec une petite interrogation "maison"). L'examen
du brevet parapente est infiniment plus complet. La circulation routière démontre
que la répression est inopérante et pour ma part je lui préfère la formation,
l'information et la liberté d'être responsable (d'autant qu'en monoplace on
n'engage pas la vie des autres) et à condition bien sûr que cette liberté s'arrête
si elle empiète sur celle des autres. Par exemple, rendre le port du casque
obligatoire me paraît relever de l'assistanat alors que convaincre les pratiquants
d'en porter un procède d'un raisonnement qui a ma préférence ; d'ailleurs l'assurance
RC n'est pas obligatoire en France en ultra-léger et nous avons tous œuvré pour
convaincre qu'elle était indispensable. J'attend avec impatience les solutions
que vous allez présenter prochainement pour améliorer la sécurité en Parapente
car c'est en effet un problème auquel on ne peut rester insensible. Vous ne
m'en voudrez pas j'espère d'avoir été plus long dans la contradiction que dans
l'assentiment et l'approbation mais c'est la loi du genre.
...................................................................................................Bien
à vous. François Sieklucki
Mon commentaire :
...A propos de l'ULM, le point sur
lequel je tiens à insister (bien qu'à mon avis une norme d'utilisation
devrait également être définie) c'est le peu de fiabilité
des matériels. Après avoir lu mon articles, ceux qui possèdent
des machines équipées de parachutes pyrotechniques auront appris
une chose : le fait que ces dispositifs de sécurité fonctionnent
n'est absolument pas garanti et le fait qu'ils soient scellés les rend
incontrôlables. Par ailleurs j'ai cité ce témoignage d'un
essayeur de parachutes de secours qui, au dessus du lac d'Annecy, eut deux éclatements
de voilure successifs. Un professionnel qui ne voulut pas témoigner sous
son nom sous peine de perdre son emploi.
...Dans l'accident cité, au centre Otto
Lilienthal de Laragne, il est clair que si le parachute de secours avait fonctionné,
il aurait sauvé la vie de deux personnes : le pilote-moniteur et sa passagère,
qui étaient chargés d'âmes tous les deux. La responsabilité
du vendeur du parachute de secours, dont la structure ne correspondait pas au
descriptif de la notice jointe, est énorme et, en amont, celle de la
société qui conçoit et fabrique ces appareils. Les parents
des victimes auraient pu intenter des procès et ceux-ci auraient été
lourdement condamnés. Encore aurait-il fallu que ces gens soient avertis
par des spécialistes. Or la justice française ne peut que se fonder
sur les "rapports d'expertises des autorités compétentes",
dépèchées sur les lieux de l'accident; à savoir
:
- La Gendarmerie de l'Air
- La DGAC
...Or dans les deux cas ces gens ignoraient tout
des ULM. Même après mon intervention officieuse, je serais curieux
de lire le rapport de l'expert de la DGAC, lequel avait prévu, après
un examen sommaire, de conclure à un "accident mortel pour cause
indéterminée". Les gendarmes et l'enquêteur de la DGAC
ne connaissaient rien aux systèmes d'extraction pyrotechniques des parachutes
de secours. Voir la remarque des gendarmes qui avaient trouvé "ce
morceau de métal à deux cent mètres du crash".
........La véritable
responsable, c'est la DGAC, de par sa complète démission en matière
de sécurité des ultra-légers.
...Pourquoi, suite à des accidents
aussi horribles, n'y a-t-il pas plus de réactions ? Parce que les gens
ne sont pas informés, ne savent pas contre qui se tourner, ou se trompent
tout simplement de cible. C'est le résultat immédiat de l'absence
de toute réglementation.
... Je note la remarque de monsieur Sieklucki concernant
les statistiques comparées d'accidents d'avion et d'ULM, quoi qu'on aimerait
bien disposer de documents fiables pour valider cette assertion. S'il nous les
fournit, nous les publierons. Il est évident que le fait de prendre des
mesures concernant l'homologation et l'entretien, le mode d'utilisation des
matériels n'éliminera pas les conséquences de fautes de
pilotage. En avion de tourisme on peut se tuer en "volant au dessus de
la couche" sans appareils de navigation et sans visibilité, ou en
"décollant au second régime", ou en se trompant de piste
et en atterrissant vent arrière ou en volant à altitude non réglementaire,
en faisant "du radada".
... L'automobile et la moto sont plus encadrés
que l'ULM, et pourtant il y a de graves accidents. Je suis parfaitement d'accord
sur ce constat et je n'irai pas verser une larme sur un conducteur qui s'est
tué en grillant un feu rouge ou en ne respectant pas une limitation de
vitesse, ou parce que ses pneus étaient complètement lisses. Sur
route, à chaque fois qu'on double une voiture ou un camion, un instant
d'inattention, de fatigue, ou d'impatience, peut vous coûter la vie. Certes.
Mais (et cela d'autant plus que les contrôles techniques périodiques
ont été instaurés) il y a sans doute peu de conducteurs
qui se tuent parce que leurs freins les lâchent soudain, que leur volant
leur reste entre les mains, ou que la fourche de leur moto se brise en plein
course, sur un nid de poule. Nous voudrions qu'au moins les gens prudents ne
voient pas leur vie mise en danger parce que des constructeurs se comportent
comme des irresponsables. A propos d'ULM, quand le jugement sera rendu, nous
ferons état d'une irresponsabilité stupéfiante (émanant
de professionnels, ayant pignon sur rue, par ailleurs prévenus de longue
date par courrier). Cela dépasse ce qu'on peut imaginer. Mais tant que
ce jugement ne sera pas rendu, il ne sera pas possible de faire mention de quoi
que ce soit, sous peine d'invalider la procédure. Ceci étant,
des gens volent toujours accrochés à des assemblages de tubes
et de toile, qui comportent de très dangereux vices de construction
, qui n'en ont été avertis, ni par le constructeur, ni par la
fédération, ni par les revues spécialisées, tous
avertis de longue date.
...La "langue de bois".
...L'histoire de l'ultra-léger abonde d'exemples de ce genre et tous ceux qui ont un peu de bouteille le savent, tous sports réunis. Dans mon texte j'ai pu paraître accorder une préférence au delta, au plan de la sécurité. Mais nous nous souvenons tous d'une machine qui, il y a plus de vingt ans, causa la mort d'un grand nombre de pilotes, à l'époque où les causes de la "mise en drapeau" avaient été parfaitement identifiées et les solutions trouvées (pose de "floating" en bout de plumes). Combien de pilotes ont alors dit au constructeur (lequel a toujours pignon sur rue) :
- Mais qu'attends-tu pour prévenir tes clients du risque qu'ils courent, en leur proposant de modifier leurs appareils ?
...Celui-là, comme tant d'autres,
ne bougea pas. Les nécessité du commerce. Le "maintien de
l'emploi de quelques personnes" vaut bien quelques sacrifices, je suppose.
Il n'est d'ailleurs pas du tout dit que si ce constructeurs avaient prévenu
ses clients, ceux-ci auraient perdu toute confiance en lui, auraient exigé
le remboursement de leur achat ou auraient cessés de lui acheter cet
appareil. Dans le monde du planeur il ne s'écoule pas de mois sans qu'un
constructeur ne signale à ses clients, à travers des revues spécialisées,
un défaut constaté sur un de ses produits (en général
un signe de mauvais comportement à la fatigue). S'il suggère le
remplacement d'une pièce ceci n'entraîne pas immédiatement
le chute de la confiance que ses clients lui portent. En ultra-léger
on ne veut pas prendre le risque de connaître une situation commerciale
difficile. Alors on préfère faire prendre à d'autres un
risque... mortel.
...Je vais vous conter une autre anedote. Près
du centre où je volais l'été dernier se trouve un magasin
de matériels pour pratiquants de l'ultra-léger. Le propriétaire
fait des baptèmes, sur ulm. Il y a deux ans j'étais passé
chez lui. Avisant sa machine, je lui dis :
- Vous devriez la vérifier, la démonter. Si c'est un ancien modèle, il est possible que celle-ci possède tel point de fragilité.
L'été suivant, je le revis. Il vint à moi :
- Vous aviez raison. La structure en question était bien
en place.
- Alors, qu'avez-vous fait ?
- J'ai écrit au constructeur en lui demandant si cela posait problème.
Il m'a répondu que non. Alors, nanti de ce certificat, j'ai revendu l'appareil.
- Et vous avez prévenu votre acheteur ?
- Non....
...Il s'était "couvert", grâce à ce certificat, mais, commerçant avant tout, "n'avait pas voulu perdre de l'argent sur cette machine". Il y a donc, en France, une personne qui vole sous un ulm qui risque à tout moment de se briser en vol. Conséquence de la "responsabilisation des usagers".
...Je reprends le courrier de monsieur
Sieklucki. Il est un fait que le casque léger, en tissu, a remplacé
les casques armés, dans le monde du parachutisme. Cela demanderait explication.
Je poserai la question à des responsables. Il est exact aussi que dans
certains clubs des pratiquants se livrent à des manoeuvres très
serrées, au ras du sol, sans le but d'épater la galerie. Dans
mon club, ça n'est pas le cas. On ne saute pas non plus en tongues. Ceci
étant, les accidents lors de la prise de terrain sont toujours possibles.
Lorsqu'on est près du sol, quelle que soit la machine volante qu'on utilise,
la logique veut qu'on redouble de prudence (phase d'atterrissage, vol près
d'un relief).
...A propos du parachutisme, je ferai la remarque
suivante. Lorsque l'équipe qui largue est compétente (et, en principe,
les largueurs le sont) les parachutiistes sont lâchés dans des
conditions telles qu'ils puissent regagner un terrain assez vaste sans encombres.
Les ailes sont aisées à piloter et leur finesse, quoique très
inférieure à celle de parapentes, leur permet d'être relativement
précis dans le choix de leur point d'aterrissage. Seuls les débutants
peuvent faire des erreurs grossières de ce côté-là.
L'été dernier l'un d'eux, en se mettant face au vent, a tiré
trop long. Il a "effacé le terrain" et s'est trouvé
en situation de se poser dans un terrain d'arbustes et de brousailles. Au dernier
moment, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire : une manoeuvre serrée,
trop près du sol. D'où décrochage (les ailes des parachutistes
décrochent de la même manière que celles de parapentistes)
et .. vilaine fracture de la cheville (opération, broches, etc..).
Le cross-country
...Ceci me montre que dans cette
présentation des sports ultra-légers j'ai oublié d'abordé
un point important : le "cross-country". Sans aller jusqu'à
une activité extrême comme le "vol-bivouac", évoqué
dans le manuel de la fédération, il est clair que dès qu'il
aura atteint un certain niveau, le pratiquant aura envie de "partir à
l'aventure", au gré des vents et des ascendances. Il est effectivement
assez grisant de couvrir des distances de vingt, trente ou cinquante kilomètres
et bondissant de crète en crète, de cumulus en cumulus. Il n'est
alors pas évident qu'à terme du voyage, lors que le dieu Eole
vous abandonne, un terrain régulièrement utilisé, muni
d'une manche à air, se présente (mais on a vu plus haut comment
évaluer sa direction au sol, en l'absence de cet accessoire). Les parapentistes
sont alors les mieux lotis de la bande, leurs machines pouvant s'accommoder
de terrains assez exigus, voire de chemins bordés d'arbustes (sur lesquels
un delta viendrait s'accrocher).
...Le choix du terrain est alors un geste capital.
Bien souvent il relèvera de la prudence maximale, le pilote préférant
se poser dans un terrain relativement dégagé que de prendre un
pari trop problématique sur l'existence d'une ascendance lors du survol
d'une région relativement peu propice à une prise de terrain.
Ceux qui pilotent longtemps agissent ainsi. Si le parapentiste peut couvrir
aisément des kilomètres avec sa voile repliée dans un sac,
c'est moins facile pour le pilote de delta, dont la machine dépasse souvent
les 25 kilos. Parmi ces choix il y aura parfois celui de se poser dans coin
difficilement accessible en voiture, lors de l'opération de "retrouving"
(comme disent les pilotes de Montgolfière), ou dans un alpage.
... J'ai connu des gens qui ont terminé
leur vie dans un fauteuil roulant parce qu'ils ont craint de devoir marcher
un kilomètre ou deux avec leur aile sur l'épaule, le long d'une
rivière. De l'autre côté il y avait des murs, des fils électriques.
...Il y a des pilotes qui oublient aussi que leur
machine humaine est infiniment plus précieuse que ces assemblages de
dacron, de nylon et/ou de tubes d'alliages légers. Il faut mieux dix
mille francs de casse, en ayant fait un superbe décrochage, parfaitement
déclenché, au dessus d'un petit bois, quitte à se retrouver
pendu en l'air, qu'un crash dans une région accidentée.
...Toujours dans le domaine du parachutisme, quid
d'une ouverture intempestive en altitude ? J'ai vu le cas se produire il y 40
ans, quand les matériels étaient de moins bonne qualité
et les clubs.. bien pauvres. Nous avons même eu ... un noyé. Un
jeune appelé qui, dans le cadre d'un club militaire se vit entraîner
dans les eaux du lac du Bourget. Il ne savait pas nager...
...L'été dernier, sur l'aire d'atterrissage
de Saint-Hilaire du Touvet, j'ai vu à quelques dizaines de mètres
de moi un garçon d'à peine plus de vingt ans multiplier les acrobaties
en parapente, juste avant contact sol, qui s'opéra à l'issue d'une
dernière ressource. Que se passera-t-il le jour où une turbulence
invisible provoquera un décrochage dynamique pendant une de ces splendides
figures de style ? Que se passera-t-il lorsqu'un pilote moins aguerri, voire
un débutant, sera tenté de l'imiter ?
... Nous sommes ramenés à la comparaison
entre les différents sports aériens. Faut-il autoriser "tout
ce qui ne mettrait pas en danger la sécurité d'autrui" ?
... On a vu qu'au début des années
soixante la fédération de parachutisme avait stoppé net
les "ouvertures basses" en prononçant quelques interdictions
de saut, sur une année. Effet radical.
... Que se passerait-il si, en avion de tourisme,
vous vous présentiez sur un terrain après avoir bouclé
un superbe tonneau ? Jusqu'à une date encore récente certains
vélivoles pouvaient encore se présenter en survolant le terrain
vent arrière, plein pot, à deux mètres du vol, pour effectuer
ensuite une PTU (prise de terrain en U) après une chandelle. Aujourd'hui
ces excentricités valent le retrait immédiat de la licence. Considèrerez
vous ceci comme une entrave à la sacro-sainte liberté individuelle
?
...La question du risque est délicate, s'agissant
de nombreux sports. Que faut-il imposer ? On a vu que les vélivoles se
voyaient imposer l'emport d'un parachute de secours (à cause du risque
de collision en vol), mais non le port d'un casque. Par contre ces accessoires
ne sont pas imposés dans l'aviation de tourisme, pourquoi ? Sans doute
parce qu'on estime d'un avion régulièrement entretenu (les appareils
se voient imposer un rythme de révisions périodiques) est relativement
fiable et n'est pas censé, pour un oui ou pour un non, se poser en pleine
campagne. Je ferai remarquer au passage que les moteurs des avions de tourisme
comportent deux magnétos indépendantes, de longue date. A l'époque
où je volais encore en ulm (j'ai cessé de le faire après
le constat positivement terrifant que j'ai fait, un jour, après démontage
d'une machine "apparemment saine") les moteurs n'en avaient qu'une
seule. Pourtant une seconde magnéto ne pèse pas bien lourd et
ne coûte pas bien cher non plus, en comparaison du prix global de l'engin.
Ce ne sont que remarques en vrac. Monsieur Sieklucki termine son message en disant :
...J'attend avec impatience les
solutions que vous allez présenter prochainement pour améliorer la sécurité
en Parapente car c'est en effet un problème auquel on ne peut rester insensible.
...Je ne me sens hélas aucune
compétence en la matière (alors qu'ils serait beaucoup plus facile
d'intervenir par exemple dans le monde de l'ULM, pour rendre ceux-ci plus sûrs).
J'ai lu, et je le crois sans peine, que le lattage des parapentes ne ferait
que les rendre plus dangereux, ceux-ci, en cas de fermeture accidentelle, ayant
plus de difficulté à se rouvrir. Faut-il limiter les allongements,
donc les performances ? Je ne sais pas. Dans cette analyse je n'ai fait que
reprendre des textes trouvés dans le manuel de la Fédération
Française de Vol Libre et qui, convenons-en, ne sont guère rassurants.
24 avril 2000. Mr Claude-François BOUYER nous écrit, de la Réunion :
...Votre exposé concernant le Delta est passionnant mais il semblerait que vous ayez beaucoup à dire sur l'ULM, alors SVP, dites le cela ne peut que nous apporter et pourquoi pas, nous faire prendre conscience de certains dangers que vraisemblablement nous ignorons. D'avance merci. Cordialement, Claude-François BOUYER. Ile de la Réunion. REUNION.MUZIK@wanadoo.fr
...Certes, il y a beaucoup à dire. J'espère aussi que des langues vont se délier. Dans le cas de l'ULM nous sommes dans l'urgence. Des machines volent actuellement qui mettent la vie de leurs pilotes en péril de mort ou peuvent faire d'eux des infirmes. D'autres sont équipées de dispositifs de sécurité qui ne sont pas en état de rendre le service qu'on attendrait d'eux en cas de gros pépin. Et il ne s'agit pas de "vieilles histoires". Un procès est en cours d'instruction, et c'est malheureusement cela qui nous empêche de dire quoi que ce soit à propos de cette affaire, sous peine d'invalider la procédure en cours. Mais dès que le jugement sera rendu, le public découvrira avec effarement jusqu'où les choses peuvent aller, en matière d'incompétence lors de la conception d'une machine volante.
... Les gens qui m'ont lu savent que je cherche pas à rogner leurs ailes, à faire disparaître des sports merveilleux. Mais je trouve inacceptable qu'en l'an 2000 on laisse n'importe qui concevoir, construire et vendre n'importe quoi, sans le moindre contrôle, que les progrès soient jalonnés de morts et d'infirmes. La solution, je l'ai évoquée. Il faut se décider à prendre en poids tous les problèmes de l'ultra-léger (projet Laroze-Petit de 1992), à travers une thèse de doctorat. L'opération serait efficace et non ruineuse. Pourquoi la DGAC était-elle restée sourde à cette demande de financement ? La réponse est simple. La solution était trop bon marché. Il n'était pas prévu de places, grassement payées, pour une kyrielle de polytechniciens chargés de "manager" un tel projet. Un appareil hiérarchique, lourd, coûteux, d'abord, avec des tas de petits copains logés aux bonnes places. Après, on voit...
... J'ai hésité à faire la confidence qui va suivre. Il s'agit d'un coup de téléphone (lesquels, c'est bien connu, ne laissent aucune trace). cela remonte à l'époque où nous essayions vaille que vaille depousser ce projet d'éclaircissement des problèmes techniques liés à l'ultra-léger, à travers cette idée de thèse d'ingénieur-docteur. J'ai eu un appel du président de la fédération d'ulm, qui m'a laissé sans voix, j'avoue. Il m'avait dit à l'époque en substance :
- Je vais peut-être beaucoup vous choquer, mais je vais vous dire une chose : les mauvais constructeurs s'éliminent par eux-mêmes.
11 septembre 2002 : un message d'un lecteur :
Bonjour,
Je réagis positivement à votre article web sur le parapente. Le
parapente est une aberration, une hérésie ! J'ai commencé
la pratique de ce sport en 1998. J'habite dans le vexin, zone verte du val d'oise
à la frontière de la Haute-Normandie et de la Picardie. J'ai très
vite réalisé que pour pouvoir évoluer sur les ridicules
dénivelés de cette région, il me faudrait atteindre un
niveau compétition. J'ai travaillé avec rigueur et acharnement
pendant 3 ans et, paradoxalement, plus ma maîtrise devenait flagrante
plus je mesurais les limites de cet aéronef : de fait, ma vulnérabilité.
Nous sommes au début de l'année 2001 : je me dis qu'un engin qui
se réclame planeur ultra-léger et dont la vitesse/air maximale
est de 38 km/h (je ne compte pas l'utilisation de l'accélérateur
qui place le parapente hors domaine de vol), oui je me dis que cet engin n'est
qu'une abérration ! 15 km/h en plaine donne 25 km/h avec le venturi du
haut de la pente et 35-40 km/h avec le gradient et les raffales, c'est de la
folie ! A ses débuts, le parapente était un modeste parachute
de pente, et tout allait bien. Mais la grenouille a voulu se faire aussi grosse
que le boeuf et le "chiffon volant" a cru qu'il pourrait jouer au
planeur avec son misérable domaine de vol.
Et puis, il y a eu ce fameux dimanche 22 avril 2001. Le cadre : un site delta
et parapente de Seine-Maritime orienté plein sud. Il est 14h00 : je décolle
et suis le premier dans l'espace aérien. Je vois une flèche filer
à toute allure sous mes pieds. Je suis surpris qu’il décolle déjà
: j'aurais préféré qu'il me laisse prendre un peu d'altitude.
Mais pas de panique c’est un Ixbow, donc le pilote qui est dessous est forcément
un bon ! Il avale quelques dizaines de mètres sans effort, tout en continuant
de prendre de l’altitude. Je le vois virer à gauche. Il va s’écarter
du relief puisque j'ai le relief à ma droite : il m'a forcément
vu ! Mais non, bien au contraire, il resserre son virage. La collision est inévitable
: je hurle pour l’avertir de ma présence. Sa vitesse est trop importante
et ses tentatives pour m’éviter sont vaines, les miennes impossibles
du fait du relief qui me bloque et de la vitesse moindre d’un parapente en regard
de celle d’un IXBOW. Son bord d'attaque frappe mon cône de suspentage
et mon aile coiffe son aile. Par effet pendulaire, je suis projeté comme
un pantin sur son trapèze et m'explose le sternum et les poumons... Ma
respiration est bloquée... Par retour de balancier, je suis à
présent sur l'extrados de son aile à une trentaine de mètres
d'altitude... Je ne peux toujours pas respirer... Nous chutons comme un vulgaire
sac de patates. Je suis allongé sur le dos et je ne peux toujours pas
respirer. Mais camarades se ruent sur moi et s'inquiètent de mes jambes.
Mes jambes, je m'en tape : ce que je veux, c'est respirer. Après une
éternité, je peux péniblement respirer... Mes poumons sont
pleins de sang mais c'est bon, je ne vais pas crever asphyxié ! Le pilote
du rigide, quant à lui, est dans le coma et son corps est affalé
sur le mien... Il se réveille en hurlant de douleur et je hurle avec
lui : j'ai mal, j'ai mal aux poumons et au sternum, j'ai tellement mal que je
ne sens pas encore mes fractures vertébrales. Je serai immobilisé
pendant quatre mois dont trois dans un corset. Après huit mois de convalescence,
je veux reprendre les airs. Je vole de décembre 2001 à mai 2002
dans un état de stress qui s'accroît au fil des semaines. J'ai
voulu mater ma peur et je n'y suis pas parvenu. C'est le printemps : la masse
d'air est très instable et les accélérations brutales,
mais je veux mater cette satanée peur qui me colle au ventre depuis l'accident.
Une raffale me jette dans un arbre : rien de cassé, juste une bonne leçon
! Le monde du vol libre est une secte, un univers sclérosé où
les conversations sont pauvres et nombrilistes : j'arrête ce sport sans
regrets en mai 2002. Non, vraiment, le parapente n'a pas l'étoffe (joli
jeu de mots !) d'un planeur ultra-léger, sauf, peut-être, pour
de rares occasions : un vol sur la Dune du Pilat, un jour sans affluence, ou
un vol de restitution au dessus du Lac d'Annecy.
Bravo pour avoir eu le courage d'éditer votre point de vue !
Bien à vous.
Vincent Ziegler
15 sept 2002. Un message d'un lecteur.
Bonjour,
Je viens de visiter votre site et surtout de lire votre témoignage d'un
accident de pendulaire.
Je prends actuellement des cours de vol sur ULM Pendulaire, dans le but d'obtenir
le brevet bien sûr, et ce témoignage me fait vraiment froid dans
le dos. Ayant pourtant bien parlé avec mon instructeur, je n'était
pas encore conscient que les machines sur lesquelles nous volons sont si peu
fiables. Et ce, par négligence du ou des constructeurs. Je savais que
ces machines n'étaient pas certifiées mais j'avais vraiment confiance
à toute la partie mécanique. De plus cette loi du silence que
vous décrivez n'est pas rassurante du tout, surtout si même Vol
moteur, que je lis, rentre dans ce jeu.
Je vole donc depuis peu de temps, j'apprécie vraiment ce sport, et suis
bien décider à aller jusqu'au bout. J'envisage aussi à
plus ou moins long terme d'acheter une machine d'occasion. Pourriez vous m'indiquer
quelle machine, de quel constructeur ( Je n'en connais que trois français
relativement important ) il faut impérativement éviter. Et aussi,
selon vous lequel de ces trois constructeurs est le plus sérieux et il
y a-t-il une machine sûre.
Merci pour vos réponses.
C Navoret (Dept 01)
12 juillet 2007 : &&& Les extraits mentionnés dans cette page proviennent d'une enquête datant de 2001. Si les choses ont changé, un lecteur m'indiquera les éventuels changements et progrès réalisés en matière de sécurité et de réglementation. J'en ferai alors état